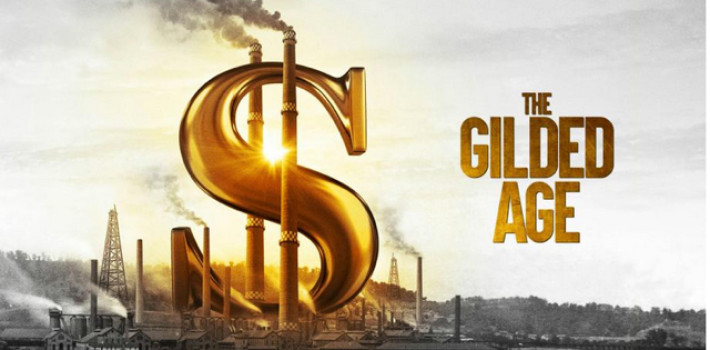Un néo-féodalisme global post-capitaliste
Et si le capitalisme avait déjà muté en un régime plus redoutable?
Un néo-féodalisme global post-capitaliste
Et si le capitalisme avait déjà muté en un régime plus redoutable ? McKenzie Wark, dans Capital is Dead, avance une hypothèse troublante : nous ne vivons plus dans le capitalisme industriel classique, mais dans un système dominé par le contrôle de l’accès – aux soins, au savoir, aux réseaux – devenu la principale source de pouvoir et d’inégalités. Ce régime post-capitaliste revêt les habits d’un féodalisme numérique, globalisé, opaque. Un monde où la propriété n’est plus matérielle, mais algorithmique, où les murs sont faits de codes, de données et de dépendance.
Des brevets comme forteresses
Les brevets médicaux, conçus pour stimuler la recherche, sont devenus des outils de rente. Les géants pharmaceutiques vendent à prix d’or des traitements largement financés par le public, tout en verrouillant leur accès dans les pays vulnérables. Pfizer, Gilead, Moderna… Ces entreprises agissent comme des seigneurs modernes de la santé mondiale. Leur pouvoir repose sur la captation d’un bien commun : la vie. La santé devient un privilège, et les brevets, des murailles invisibles.
Une école pour les seigneurs
L’éducation mondiale, jadis promesse d’ascension sociale, se privatise. En Afrique, au Brésil, en Inde, les écoles privées prolifèrent ; en Occident, les universités d’élite se ferment aux classes populaires. Les diplômes prestigieux font office de titres de noblesse. Le savoir circule sous haute surveillance. Plateformes, IA, contenus pédagogiques… tout appartient à une poignée de multinationales. Ce n’est plus une école pour tous, mais un système féodal où l’instruction devient un monopole intellectuel.
Les nouveaux réseaux féodaux
Les géants du numérique – Meta, Google, Apple, Tencent, Amazon – règnent sur des réseaux planétaires d’information, de commerce, d’émotion. Ils hiérarchisent. Leur architecture favorise l’accumulation au sommet. Le pouvoir ne réside plus dans les usines, mais dans les serveurs, les algorithmes, les lignes de code. Les États deviennent des vassaux. Les citoyens, réduits au rang d’utilisateurs, vivent dans des plateformes dont ils ne maîtrisent ni les règles ni les logiques.
Un monde privatisé
La terre, l’eau, les semences, les données, les gènes : tout devient propriété privée. Des fonds spéculatifs achètent des régions entières, des plateformes monétisent nos pulsions, des biotechs brevetent le vivant. Même nos émotions, nos gestes les plus intimes sont traduits en données exploitables. Ce n’est plus le capital productif qui gouverne, mais un capital extractif. Un capitalisme sans usine, mais avec des mines invisibles : nos vies.
Travailleurs sans fief
Des millions de personnes travaillent sans contrat, ni droits, ni protection. Chauffeurs Uber, livreurs, influenceurs, microtaskers… tous dépendent d’un accès conditionné aux plateformes. Ce n’est plus un lien salarial, mais une vassalité algorithmique. L’algorithme décide, récompense ou bannit. Le servage digital organise une précarité massive sous couvert d’autonomie.
La ville comme lieu d’oubli
Depuis 2008, la majorité de l’humanité vit en ville. Ce basculement transforme notre rapport au monde : moins de nature, plus de vitesse. Les villes sont des lieux de transit, saturés de flux, d’écrans, de bruit. L’espace s’y contracte, le temps s’y accélère. Même dans la foule, chacun est isolé. L’urbanité devient un désancrage.
Résistances dispersées, pouvoir concentré
Partout, des colères émergent : luttes écologistes, féministes, sociales. Mais ces résistances, bien que sincères, sont fragmentées. Pendant ce temps, les monopoles s’installent, renforcés par l’inaction des États. Les politiques néolibérales poursuivent leur œuvre : dérégulation, marchandisation. Les communs s’effritent.
Une extrême droite avec le vent en poupe
Le résultat du désarroi provoqué par cette offensive sans précédent qui ferme la parenthèse ouverte par la destruction du mur de Berlin en 1989 et la guerre d’Ukraine en 2011, est un repli des peuples sur ce qu’ils pensent être leurs intérêts. Or la gauche ancienne est en miettes et seuls subsistent des lambeaux qui ont pris les habits du libéralisme. Sur un tel terrain, l’extrême droite en promettant la sécurité, la lutte contre un Islam ressenti comme menaçant à le vent en poupe sous différentes apparences. Et pourtant en s’alignant sur Donald Trump, elle ne fait que renforcer les principales causes des inégalités grandissantes.
Transformer le réseau
Un autre monde est possible, mais exige une refonte radicale. Il faut :
• Briser les monopoles, ouvrir les systèmes fermés ;
• Garantir un accès universel aux infrastructures vitales ;
• Réguler les réseaux pour qu’ils libèrent plutôt que dominer ;
• Réinventer une société fondée sur le soin, la lenteur, la solidarité.
Changer les réseaux, c’est transformer le monde. C’est rompre avec l’illusion de la modernité infinie pour bâtir un futur habitable.
GXC
Photo : D.R
Et si le capitalisme avait déjà muté en un régime plus redoutable ? McKenzie Wark, dans Capital is Dead, avance une hypothèse troublante : nous ne vivons plus dans le capitalisme industriel classique, mais dans un système dominé par le contrôle de l’accès – aux soins, au savoir, aux réseaux – devenu la principale source de pouvoir et d’inégalités. Ce régime post-capitaliste revêt les habits d’un féodalisme numérique, globalisé, opaque. Un monde où la propriété n’est plus matérielle, mais algorithmique, où les murs sont faits de codes, de données et de dépendance.
Des brevets comme forteresses
Les brevets médicaux, conçus pour stimuler la recherche, sont devenus des outils de rente. Les géants pharmaceutiques vendent à prix d’or des traitements largement financés par le public, tout en verrouillant leur accès dans les pays vulnérables. Pfizer, Gilead, Moderna… Ces entreprises agissent comme des seigneurs modernes de la santé mondiale. Leur pouvoir repose sur la captation d’un bien commun : la vie. La santé devient un privilège, et les brevets, des murailles invisibles.
Une école pour les seigneurs
L’éducation mondiale, jadis promesse d’ascension sociale, se privatise. En Afrique, au Brésil, en Inde, les écoles privées prolifèrent ; en Occident, les universités d’élite se ferment aux classes populaires. Les diplômes prestigieux font office de titres de noblesse. Le savoir circule sous haute surveillance. Plateformes, IA, contenus pédagogiques… tout appartient à une poignée de multinationales. Ce n’est plus une école pour tous, mais un système féodal où l’instruction devient un monopole intellectuel.
Les nouveaux réseaux féodaux
Les géants du numérique – Meta, Google, Apple, Tencent, Amazon – règnent sur des réseaux planétaires d’information, de commerce, d’émotion. Ils hiérarchisent. Leur architecture favorise l’accumulation au sommet. Le pouvoir ne réside plus dans les usines, mais dans les serveurs, les algorithmes, les lignes de code. Les États deviennent des vassaux. Les citoyens, réduits au rang d’utilisateurs, vivent dans des plateformes dont ils ne maîtrisent ni les règles ni les logiques.
Un monde privatisé
La terre, l’eau, les semences, les données, les gènes : tout devient propriété privée. Des fonds spéculatifs achètent des régions entières, des plateformes monétisent nos pulsions, des biotechs brevetent le vivant. Même nos émotions, nos gestes les plus intimes sont traduits en données exploitables. Ce n’est plus le capital productif qui gouverne, mais un capital extractif. Un capitalisme sans usine, mais avec des mines invisibles : nos vies.
Travailleurs sans fief
Des millions de personnes travaillent sans contrat, ni droits, ni protection. Chauffeurs Uber, livreurs, influenceurs, microtaskers… tous dépendent d’un accès conditionné aux plateformes. Ce n’est plus un lien salarial, mais une vassalité algorithmique. L’algorithme décide, récompense ou bannit. Le servage digital organise une précarité massive sous couvert d’autonomie.
La ville comme lieu d’oubli
Depuis 2008, la majorité de l’humanité vit en ville. Ce basculement transforme notre rapport au monde : moins de nature, plus de vitesse. Les villes sont des lieux de transit, saturés de flux, d’écrans, de bruit. L’espace s’y contracte, le temps s’y accélère. Même dans la foule, chacun est isolé. L’urbanité devient un désancrage.
Résistances dispersées, pouvoir concentré
Partout, des colères émergent : luttes écologistes, féministes, sociales. Mais ces résistances, bien que sincères, sont fragmentées. Pendant ce temps, les monopoles s’installent, renforcés par l’inaction des États. Les politiques néolibérales poursuivent leur œuvre : dérégulation, marchandisation. Les communs s’effritent.
Une extrême droite avec le vent en poupe
Le résultat du désarroi provoqué par cette offensive sans précédent qui ferme la parenthèse ouverte par la destruction du mur de Berlin en 1989 et la guerre d’Ukraine en 2011, est un repli des peuples sur ce qu’ils pensent être leurs intérêts. Or la gauche ancienne est en miettes et seuls subsistent des lambeaux qui ont pris les habits du libéralisme. Sur un tel terrain, l’extrême droite en promettant la sécurité, la lutte contre un Islam ressenti comme menaçant à le vent en poupe sous différentes apparences. Et pourtant en s’alignant sur Donald Trump, elle ne fait que renforcer les principales causes des inégalités grandissantes.
Transformer le réseau
Un autre monde est possible, mais exige une refonte radicale. Il faut :
• Briser les monopoles, ouvrir les systèmes fermés ;
• Garantir un accès universel aux infrastructures vitales ;
• Réguler les réseaux pour qu’ils libèrent plutôt que dominer ;
• Réinventer une société fondée sur le soin, la lenteur, la solidarité.
Changer les réseaux, c’est transformer le monde. C’est rompre avec l’illusion de la modernité infinie pour bâtir un futur habitable.
GXC
Photo : D.R