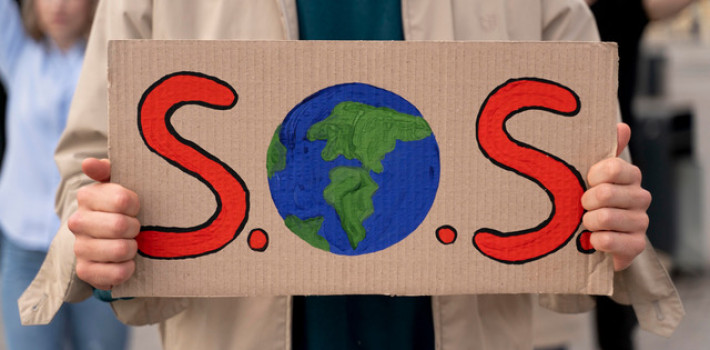Aléas climatiques : le défi de l’agriculture insulaire
Le changement climatique bouleverse les productions locales, ......
Aléas climatiques : le défi de l’agriculture insulaire
Le changement climatique bouleverse les productions locales, avec des répercussions sociales et économiques majeures. Oléiculteurs et producteurs de kiwis voient leur savoir-faire menacé et cherchent des solutions pour l’avenir.
Olives et kiwis fragilisés
La filière oléicole traverse une saison catastrophique. Après une floraison prometteuse, la chaleur précoce, la sécheresse et les tempêtes ont détruit la récolte : moins de 15 % des volumes habituels sont attendus. 80 % des producteurs de la coopérative oléicole de Balagne n’ont rien récolté, seuls ceux qui irriguent s’en sortent. Olives de petite taille et fruits secs témoignent de la gravité de la situation. Les pertes économiques sont lourdes et la survie des exploitations est en jeu, tout comme un patrimoine paysager et culturel. Les kiwis sont aussi fragilisés. La douceur hivernale et la raréfaction du froid perturbent la culture du kiwi. Les producteurs notent une baisse de rendement et une hausse des risques de dépérissement, aggravés par des sols engorgés ou des pluies excessives. En 2025, la filière doit surveiller les nuisibles comme la punaise diabolique et les aleurodes, tout en valorisant la qualité et la conservation du kiwi corse. Malgré l’IGP obtenue en 2021, le manque d’investissement et les dérèglements climatiques fragilisent l’avenir du secteur, rendant l’innovation indispensable.
Diversification en question
Face à la répétition des sécheresses, tempêtes et vagues de chaleur, la dépendance à une seule culture expose fortement les exploitations aux risques climatiques. La diversification consiste à introduire différentes espèces végétales — comme le kiwi jaune en complément du kiwi vert, ou encore des cultures fourragères et des arbres adaptables au stress hydrique —, mais aussi à varier les activités agricoles, du maraîchage à l’élevage ou l’agritourisme. Certains oléiculteurs envisagent la reconversion vers l’olive de table ou de nouveaux marchés, cherchant à s’adapter face à l’instabilité climatique. La forte baisse de revenus pousse certains agriculteurs à cesser leur activité. En 2022, les pratiques biologiques ont progressé de 25 % sur l’île, attestant l’effort vers des systèmes plus résilients. Les politiques actuelles (PAC, plan de structuration 2021-2025 doté de 42 millions d’euros pour la Corse) financent innovations, circuits courts, agroécologie et adaptation des infrastructures (irrigation, haies, outils d’observation météorologique). Ainsi, la diversification représente un enjeu autant de souveraineté alimentaire que de durabilité économique et sociale pour l’agriculture insulaire. C’est aussi une condition pour maintenir l’emploi, freiner la désertification rurale et pérenniser le tissu agricole face à un climat devenu imprévisible.
Miser sur la résilience
La résilience agricole en Corse repose sur des initiatives territoriales et nationales labellisées « aires agricoles de résilience climatique », visant à adapter les exploitations aux aléas climatiques. Les démarches territoriales sous ce label rassemblent les acteurs pour piloter des projets collectifs ancrés dans chaque microrégion. Parmi les exemples récents figurent l’expérimentation de nouvelles cultures résistantes à la sécheresse et au stress hydrique, notamment dans la Plaine orientale et le Nebbiu, la mise en place d’observatoires agricoles du climat, pour anticiper les épisodes extrêmes et adapter les pratiques culturales, la création de plateformes d’innovation agroécologique, où les agriculteurs testent la diversification des cultures légumières, fruitières et fourragères. Cette approche valorise la mutualisation des moyens et la synergie entre filières, tout en optimisant la gestion des ressources naturelles (sol, eau, biodiversité). Lancé en 2024, le Plan Méditerranée soutient la transformation du secteur en générant des projets collectifs réunissant producteurs, chercheurs et institutions, notamment pour l’agroécologie, la diversification des filières, la mutualisation des infrastructures d’irrigation, ainsi que le développement de variétés adaptées à un climat plus chaud et plus sec. Ces démarches anticipent la gestion durable des ressources naturelles (eau, sol, biodiversité), soutiennent la transmission du savoir-faire, contribuent à maintenir l’emploi rural, et ouvrent l’accès à des financements dédiés, tout en renforçant la souveraineté alimentaire régionale.
Maria Mariana
Crédits photographiques
· 11499_2025-11-21_alexphotos_Mains tenant des olives_244.jpg : © alexphotos
· 11499_2025-11-21_kotkoa_arbres-oliviers.jpg: © kotkoa
· 11499_2025-11-21_freepik_protest against climat_2149040349.jpg: © freepik