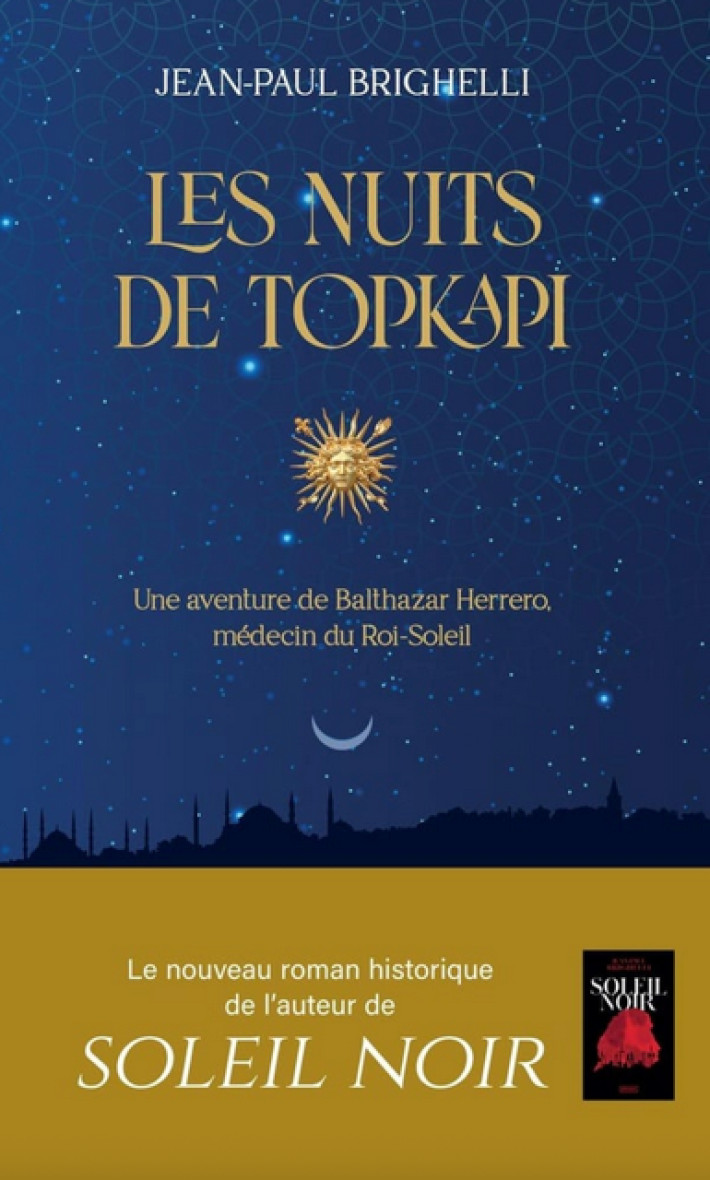Les Nuits de Topkapi ou l'art de conter l'histoire comme une épopée
Brighelli livre un roman jubilatoire, érudit et théâtral, dans lequel il déploie tout son art du récit historique, tout en y injectant une ironie très contemporaine.
Les Nuits de Topkapi ou l’art de conter l’Histoire comme une épopée
Après Soleil noir, qui mettait en scène les débuts de Balthazar Herrero, médecin du roi Louis XIV, Jean-Paul Brighelli revient avec Les Nuits de Topkapi, fresque orientale et baroque où l’aventure permet une réflexion érudite sur la politique, la médecine, le désir et la civilisation. Entre les fastes du palais ottoman et les intrigues de cour, Brighelli livre un roman jubilatoire, érudit et théâtral, dans lequel il déploie tout son art du récit historique, tout en y injectant une ironie très contemporaine.
Une mission diplomatique au cœur de l’Empire ottoman
Le roman s’ouvre en 1688, alors que gronde la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Louis XIV envoie Balthazar Herrero, son médecin attitré, à Constantinople. Officiellement, Herrero est chargé de soigner le sultan, frappé d’un mal honteux que l’auteur ne manque pas d’assaisonner de détails croustillants. Officieusement, la mission est triple : nouer une alliance contre l’Autriche, éliminer le chef d’une secte radicale (les Hashichins), et résoudre, à sa façon, les conflits internes à la Sublime Porte. Dès les premières pages, Brighelli plante un décor flamboyant, fait de palais miroitants, de bazars labyrinthiques, de hammams, de tempêtes en mer Égée et de couloirs secrets. Le héros, quant à lui, évolue avec un sang-froid impeccable : « Un médecin n’est pas un soldat, disait Balthazar, mais il connaît mieux que personne l’anatomie de ses ennemis. » Cette phrase, faussement humble, résume bien le ton du roman : érudit, cynique, élégamment amoral.
Une galerie de personnages hauts en couleur
Brighelli s’amuse à mêler fiction et figures historiques. Antoine Galland, futur traducteur des Mille et Une Nuits, accompagne le héros avec la maladresse charmante du lettré propulsé dans l’action. Il croise la route de Gaspard, géant huguenot au cœur tendre, évadé des galères, et surtout Haydée, esclave affranchie d’une lucidité redoutable, dont la présence féminine apporte une tension sensuelle au récit. Le dialogue entre cette dernière et Herrero, à propos de la liberté et du plaisir, sonne comme une mise en abyme du roman lui-même : « Le harem est une prison dorée. Mais vous, docteur, que cache votre science sinon un autre genre de cage ? » Les seconds rôles – vizirs calculateurs, espions arméniens, religieuses fanatiques – renforcent cette impression de foisonnement romanesque à la Dumas, dont Brighelli revendique explicitement l’influence.Entre humour et profondeur
Mais là où l’auteur surprend, c’est dans la légèreté apparente avec laquelle il traite des sujets graves. Brighelli manie avec brio l’humour décalé en référence avec l’actualité. On pense notamment à cette scène où Herrero, poursuivi par des janissaires, se réfugie dans une bibliothèque interdite du palais : « Il se dit qu’il y avait pire endroit pour mourir que parmi les livres. Encore fallait-il ne pas glisser sur les versets du Coran. » Sous ce vernis malicieux, apparaît une méditation sur la civilisation, le fanatisme, et le corps. Le roman parle aussi, souvent, de la médecine comme d’un art politique. Soigner un sultan, c’est aussi soigner un empire. L’auteur n’hésite pas à placer dans la bouche de son héros des sentences mémorables : « Les puissants ne tombent pas malades. Ils rendent le monde malade à leur place. »Une plume virtuose et foisonnante
Le style de Brighelli est riche, parfois lyrique, volontiers ironique. Il jongle avec les registres, passant du romanesque flamboyant à l’allusion savante, de la digression érudite au clin d’œil grivois. Le tout forme un tissu narratif dense, parfois trop pour les lecteurs en quête de simplicité. Mais c’est justement ce baroque assumé qui fait tout le charme du livre. Le roman est aussi traversé par un regard lucide sur le pouvoir et l’idéologie. Derrière l’intrigue d’espionnage, c’est un monde au bord du basculement que décrit Brighelli. L’Orient n’est pas idéalisé, mais montré dans sa complexité : déclin de l’empire ottoman, montée des dogmatismes, violence des rapports sociaux. Comment ne pas penser au présent ? À cela, le héros n’oppose ni foi ni idéologie, mais une forme de scepticisme actif, une pensée vive, faite d’expérience et d’humour.
Un livre à dévorer avec passion
Avec Les Nuits de Topkapi, Jean-Paul Brighelli réussit le pari de divertir tout en instruisant, de faire revivre une époque sans jamais tomber dans le pédantisme. Certains pourront lui reprocher une abondance narrative, une propension à la digression, ou encore des personnages parfois archétypaux. Mais ces traits relèvent moins de défauts que de choix esthétiques : celui du foisonnement, du plaisir du texte, de la langue généreuse. À qui aime Dumas, Le Carré, les contes orientaux et l’histoire des idées, Les Nuits de Topkapi offrira une lecture aussi dense que savoureuse.GXC
Photo: Jean-Paul Brighelli
Les nuits de Topkapi : Une aventure de Balthazar Herrero, médecin du Roi-Soleil, Jean-Paul Brighelli, éd. de l'Archipel, 22 €