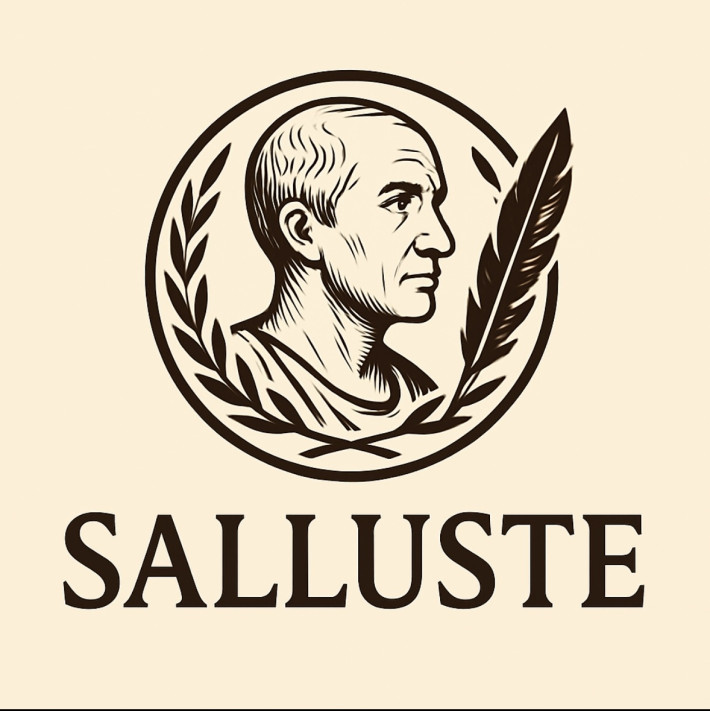La mémoire et l’oubli : faut-il élargir les cas d’imprescriptibilité aux crimes sexuels sur mineurs ?
On entend souvent que l’imprescriptibilité dans la punition de certains crimes doit voir son champ d’application étendu.
La mémoire et l’oubli : faut-il élargir les cas d’imprescriptibilité aux crimes sexuels sur mineurs ?
On entend souvent que l’imprescriptibilité dans la punition de certains crimes doit voir son champ d’application étendu.
On considère que l’imprescriptibilité, que l’on réservait habituellement aux crimes dits « contre l’humanité » - entendant par là signifier que lesdits crimes sont si attentatoires à ce qui fait la singularité de la nature humaine, qu’on pouvait permettre leur punition sans condition de délai (ce qui peut aussi se discuter) - devait s’étendre à d’autres domaines.
Aujourd’hui, on peut lire que, par exemple, les crimes sexuels commis sur des mineurs doivent être aussi imprescriptibles.
On peut comprendre que le mineur étant mineur, il n’a pas tout le pouvoir ou tout le discernement nécessaire pour dénoncer les horribles atteintes dont il fait l’objet et que le décompte du délai ordinaire pour ce faire, et obtenir la juste punition, ne pourra intervenir qu’à sa majorité. Cela se défend et se conçoit.
Faut-il pour autant admettre qu’il n’y ait plus de délai dès lors que la victime est devenue majeure ?
La question se pose.
Certes ce sont des crimes horribles dont il est question, car on touche ici à l’innocence, à des êtres fragiles, car en construction, auxquels la société doit la protection qu’ils ne peuvent, par nature, assurer eux-mêmes.
On notera qu’on n’a pas eu les mêmes attentions, sans vouloir faire preuve de mauvais esprit, en libéralisant les possibilités d’avortement ou en facilitant, récemment, les possibilités de tuer ceux qui le demandent, pour leur bien évidemment !
Drôle d’époque qui n’en est pas à une contradiction près.Cela signifie, quoi qu’il en soit, qu’il n’y a pas de cohérence, peut-être parce qu’il n’y a plus de pensée.
La question de la prescription pose celle, plus générale, de la mémoire, et celle de l’oubli [1].
Faut-il ne rien oublier ? Et, plus précisément, peut-on vivre sans oublier certaines choses ?
La religion chrétienne nous donne une première réponse, celle du pardon qui est un oubli, pour avoir une nouvelle chance, une nouvelle vie. Pour repartir d’un « bon pied », en espérant que ce sera un pied plus sûr, celui dont les pas seront nourris par l’expérience des erreurs passées.
Dans la plupart des systèmes juridiques on considère généralement que la société ne peut plus demander des comptes au bout d’un certain temps car cela créerait plus de désordre que d’ordre.
L’oubli est ainsi conçu comme un outil de paix sociale.
L’idée même de la prescription se fonde également sur le fait que celui qui a à se plaindre de quelque chose doit le faire assez rapidement selon la nature de ce dont il entend se plaindre. S’il ne le fait pas, cela signifie que la chose en question ne lui cause, en réalité, ni grand trouble, ni grand préjudice.
Un certain nombre de penseurs nous dit qu’on doit oublier, car on ne peut vivre avec un étagement permanent de griefs et de douleurs qui seraient trop lourds à porter et nous empêcheraient d’être debout, donc vivants.
Le système de répression pénale est également orienté en ce sens malgré quelques exceptions que l’on veut aujourd’hui multiplier en bouleversant l’ordre ancien.
C’est bien là la marque de notre époque, celle des apprentis sorciers qui considèrent que pour être modernes il faut faire table rase de l’antique sagesse et de tous les principes qui ont constitué le fondement de nos civilisations.
Ces dérives sont inquiétantes car elles participent d’une volonté de nier le passé, le legs de nos anciens, de ce qui nous vient de la mémoire des siècles.
Ces nouveaux « penseurs » veulent marquer leur époque et considèrent que tout ce qui était doit disparaître par principe.
Les prescriptions qui existaient doivent ainsi être mises à terre car traduisant une pensée vieillotte.Il faut s’insérer, nous disent-ils, dans le présent, en oubliant toutefois que sans passé il ne peut y avoir de présent.Ces attitudes, qui ont pourtant un écho certains, tant le suivisme et le souci de plaire sont aussi la marque de notre temps.Ce faisant, elles s’inscrivent parfaitement dans la phase de pensées molle et de déliquescence qui caractérise le moment que nous vivons.
S’agissant des atteintes et violences sexuelles contre les mineurs, la répression pénale pouvant intervenir sans délai, cinquante ans après par exemple, apportera-t-elle réparation à la victime qui s’est « construite » (tant bien que mal, mais tout un chacun se construit comme il peut) ? On n’en est pas certain.
Se pose également la question de la preuve de faits aussi anciens, ajoutée à la pertinence des témoignages lorsque le temps s’est écoulé.
Le délai de prescription de trente ans est déjà suffisamment long pour permettre la répression, nous semble-t-il.
Quant à la question de la réparation, que peut-on réparer si on poursuit même seulement après dix ans, et a fortiori à l’extrême limite du délai trentenaire ?
On ne sait et on se le demande.
Cela ne va-t-il pas avoir un effet inverse à celui affiché et poursuivi ? Ne va-t-on pas faire resurgir les fantômes d’un passé dont chacun, de part et d’autre, s’était accommodé ?
Les dégâts et désordres en cascade qui vont s’ensuivre, vingt-cinq ans après, ou trente-cinq ans après auront-ils un effet d’apaisement sur la victime ? Le trouble qui surgira de tout ce déballage de l’intime sera-t-il utile et efficace pour faire disparaître la violence initiale? Et les dégâts dits « collatéraux », pour utiliser un mot à la mode, ne doivent-ils pas être également un élément de notre réflexion ?
La famille, les conjoints, les enfants, les petits-enfants de la victime qui, tous, n’y sont pour rien (sauf situations particulières), vont se trouver mêlés à tout cela et devoir expier les fautes d’un autre, cet autre qui aura pu être et sera toujours pour eux un bon père, un bon mari, une bonne mère, une bonne épouse, un grand-père ou une grand-mère attentionnée.
On ne peut, hélas, remonter le temps, ce que ne comprennent pas les simples d’esprits qui, souvent, entendent pourtant faire preuve d’audace intellectuelle et révolutionner le monde.
Du côté de la victime, et de ses enfants, conjoints, petits-enfants etc, les révélations d’une violence cinquantenaire apporteront-elles quelque chose ?
Tout ce trouble, de part et d’autre, des dizaines d’années après les faits est-il le prix à payer pour satisfaire les délires vengeurs de quelques inquisiteurs aux cerveaux échevelés ?
Salluste
[1]Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli.