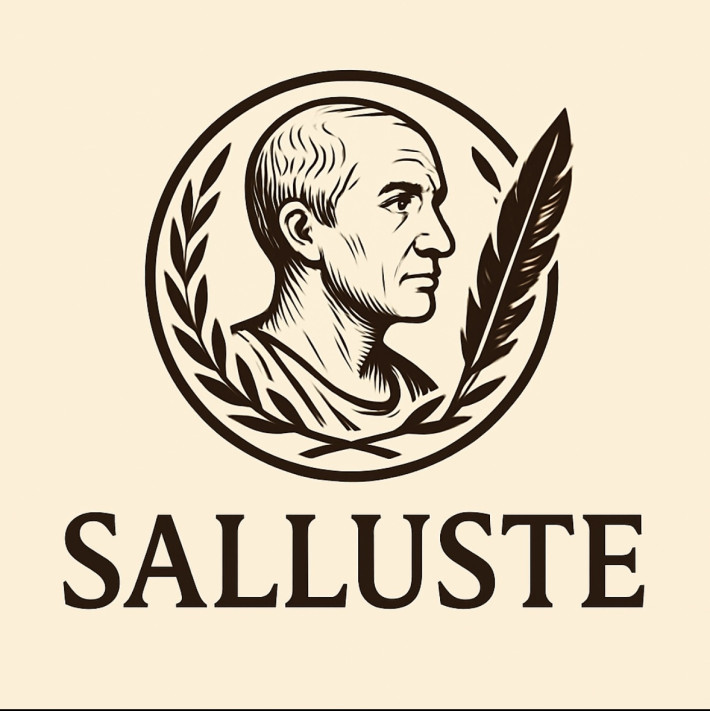Les chroniques d'Octave, natif de l'île aux Oiseaux
L' esprit d'Octave vagabondait de temps en temps.........
Les chroniques d’Octave, natif de l’Île aux Oiseaux
L’esprit d’Octave vagabondait de temps en temps, et en ces moments il pensait à son Île aux Oiseaux.
Il la voyait se couvrir de bâtiments sur ses parties planes et côtières.
Il ne connaissait plus tous les nouveaux habitants qui s’enfermaient chez eux autour de hauts murs. Parfois, la maison n’était pas encore terminée, et souvent les fondations n’étaient pas entreprises, que les murs d’enceintes, quant à eux, étaient édifiés par priorité.
Octave s’interrogeait : était-ce là la nouvelle sociabilité ? Et cela le perturbait. Allons-nous pouvoir faire société ainsi se disait-il ? Est-il possible et concevable qu’à peine arrivé on commence par s’enfermer ?
C’était la nouvelle société, une nouvelle société qui se préparait sans doute, celle des cases, toujours plus de cases.
Chacun chez soi, dans des vies émiettées et cloisonnées.
Ces nouvelles constructions, il le constatait souvent, étaient édifiées par des habitants de la terre ferme, et par d’autres venus d’autres contrées plus lointaines. Tous venaient chercher le soleil et l’image de légèreté de la vie qui, disait-on, était présente sur l’Île aux Oiseaux.
Souvent cette idée d’installation était venue aux nouveaux arrivants lors d’un bref séjour sur l’Île pendant la période estivale quand une sorte d’irréalité s’emparait des êtres (et non des choses qui, elles, restaient immuables).
Tout semblait alors possible à ceux qui venaient sur cette terre qu’ils croyaient bénie des Dieux. Le soleil, torride, des paysages variés, toujours majestueux, des rocs puissants et du sable fin qui se succédaient et se côtoyaient le temps d’un simple déplacement d’une demi-heure. Comment ne pas avoir la tête tourneboulée lorsqu’on n’y était pas habitué ?
Parmi ces arrivants, l’espace d’une saison chaude, on distinguait deux catégories.
Ceux, tout d’abord, qui pensaient que la misère est moins rude au soleil ou quelque chose d’approchant. Ils s’installaient alors comme ils pouvaient, croyant que l’on vivait de la même façon en été et en hiver, et que le climat était ainsi constant.
Ils venaient ensuite nourrir le nombre des précaires et autres allocataires de minima sociaux une fois que la bise était venue.
Les autres, mieux pourvus qui, quant à eux, se disaient qu’ils pourraient trouver sur place plus de paix et de tranquillité que d’autres îles et contrées n’apportaient plus. Ils étaient aussi attirés par le portrait qui était tracé de l’autochtone. Ce dernier était décrit comme un être rude, pétri de cette idée d’un honneur qui était issu des époques les plus vraies. En résumé un être « premier » resté dans le jus de la création divine. On ne pouvait qu’être en sécurité en des lieux ainsi peuplés.
Pour ceux-là, c’était aussi un mélange d’exotisme et de frisson qu’ils venaient chercher sur l’Île aux Oiseaux.
Dès qu’ils y avaient mis un pied, ils se mettaient en quête d’un terrain pour y bâtir ou d’une maison, que des îliens, humant un vent lucratif, s’employaient à construire en nombre à cet effet.
Dans les deux cas, c’étaient des autochtones qui vendaient, tout en assurant qu’ils étaient patriotes, très attachés à la terre de leurs ancêtres, terre qu’ils considéraient comme une sorte de sanctuaire.
Une fois sur le territoire insulaire, les nouveaux arrivants s’employaient à dompter les natifs dont on leur avait décrit le caractère, comme déjà indiqué.
Pour ce faire, et sachant qu’il avait à faire à des sortes de primates, le fraîchement débarqué se disait qu’il fallait nécessairement user de méthodes subtiles, comme celles utilisées pour apprivoiser les bêtes fauves, le primate n’en demeurant pas moins potentiellement dangereux. Aussi, la prudence s’imposait-elle.
Cela commençait par des tentatives, toujours maladroites, pour prononcer les noms de lieux et des gens selon l’usage local, comme le faisaient les natifs.
D’autres ne se donnaient même pas cette peine et continuaient à prononcer comme au premier jour (celui de leur arrivée), soit parce qu’ils étaient intellectuellement incapables de faire autrement (a-t-on besoin de l’enrichissement apporté par de telles personnes se disait Octave ?), soit parce qu’ils trouvaient qu’ils étaient d’une race supérieure et qu’ils n’avaient pas à s’abaisser à un tel effort.
Pour ceux qui essayaient c’était souvent peine perdue, le peu de natifs qui demeurait présent sur sa terre, et qui avait l’ouïe affûtée par les longs parcours sur la lande, identifiait l’intrus-comédien au premier son émis. Cela se traduisait par le fait de ressentir cette sorte de piqûre dont Octave s’était déjà fait l’écho, cher lecteur.
Ensuite, l’objectif de ces non-natifs était de pactiser, autant que faire se pouvait, avec le plus possible de natifs, le temps de déterminer ceux qui pourraient leur servir à une meilleure intégration, à savoir ne pas avoir d’ennui de quelque nature que ce fut, notamment ces ennuis qui étaient quelque peu assourdissants.
Le but de ces manœuvres n’était pas, on l’a compris, de mieux connaître (même s’il y avait quelquefois une part sincère de curiosité saine) l’âme de ce pays, et de ce qui restait de son peuple. C’était une visée purement utilitaire, dans la plupart des cas, une sorte d’assurance aussi, car on avait dit aux nouveaux arrivants que le natif était fort ombrageux et pouvait à tout moment faire le coup de poing et parfois même, même si cela se perdait, embraser les nuits de lueurs bleutées entraînant des dégâts immobiliers notables.
Attachés à leur patrimoine, les nouveaux arrivants voulaient surtout éviter cela, et étaient prêts ainsi à tous les sacrifices en prenant toutes précautions utiles.
Allant plus loin dans leur souci d’assurance, ils faisaient aussi allégeance en copinant – ostensiblement ou non – avec ceux qu’ils croyaient détenir le pouvoir du feu bleu de la nuit. Ainsi, ils s’arrangeaient aussi, comme cela leur était souvent suggéré, pour s’inscrire sur les listes électorales de l’Île aux Oiseaux et pour voter de façon visible pour des mouvements qui revendiquaient la protection de l’intégrité et de la pureté du territoire îlien. Pour éviter tout malentendu, souvent, ils donnaient procuration à des personnes sûres et bien identifiées, ce qui leur évitait de surcroît de faire un séjour sur l’Île pendant la période froide, celle généralement pendant laquelle se tenaient les opérations électorales.
Tout le monde y gagnait, l’électeur qui se disait que finalement c’était plus facile et moins coûteux qu’une surprime d’assurance, les élus qui engrangeaient un capital électoral non négligeable.
Voilà une autre illustration de la dépossession ou de ce qu’on pouvait appeler dans des terres du sud, la colonisation de peuplement.
Octave se disait que, de tous côtés, la machine à déposséder était en marche et qu’il allait être difficile de lutter si ceux vers lesquels il croyait pouvoir se tourner y participaient.
Tout cela engendrait en lui une certaine mélancolie…
À suivre...
Salluste
L’esprit d’Octave vagabondait de temps en temps, et en ces moments il pensait à son Île aux Oiseaux.
Il la voyait se couvrir de bâtiments sur ses parties planes et côtières.
Il ne connaissait plus tous les nouveaux habitants qui s’enfermaient chez eux autour de hauts murs. Parfois, la maison n’était pas encore terminée, et souvent les fondations n’étaient pas entreprises, que les murs d’enceintes, quant à eux, étaient édifiés par priorité.
Octave s’interrogeait : était-ce là la nouvelle sociabilité ? Et cela le perturbait. Allons-nous pouvoir faire société ainsi se disait-il ? Est-il possible et concevable qu’à peine arrivé on commence par s’enfermer ?
C’était la nouvelle société, une nouvelle société qui se préparait sans doute, celle des cases, toujours plus de cases.
Chacun chez soi, dans des vies émiettées et cloisonnées.
Ces nouvelles constructions, il le constatait souvent, étaient édifiées par des habitants de la terre ferme, et par d’autres venus d’autres contrées plus lointaines. Tous venaient chercher le soleil et l’image de légèreté de la vie qui, disait-on, était présente sur l’Île aux Oiseaux.
Souvent cette idée d’installation était venue aux nouveaux arrivants lors d’un bref séjour sur l’Île pendant la période estivale quand une sorte d’irréalité s’emparait des êtres (et non des choses qui, elles, restaient immuables).
Tout semblait alors possible à ceux qui venaient sur cette terre qu’ils croyaient bénie des Dieux. Le soleil, torride, des paysages variés, toujours majestueux, des rocs puissants et du sable fin qui se succédaient et se côtoyaient le temps d’un simple déplacement d’une demi-heure. Comment ne pas avoir la tête tourneboulée lorsqu’on n’y était pas habitué ?
Parmi ces arrivants, l’espace d’une saison chaude, on distinguait deux catégories.
Ceux, tout d’abord, qui pensaient que la misère est moins rude au soleil ou quelque chose d’approchant. Ils s’installaient alors comme ils pouvaient, croyant que l’on vivait de la même façon en été et en hiver, et que le climat était ainsi constant.
Ils venaient ensuite nourrir le nombre des précaires et autres allocataires de minima sociaux une fois que la bise était venue.
Les autres, mieux pourvus qui, quant à eux, se disaient qu’ils pourraient trouver sur place plus de paix et de tranquillité que d’autres îles et contrées n’apportaient plus. Ils étaient aussi attirés par le portrait qui était tracé de l’autochtone. Ce dernier était décrit comme un être rude, pétri de cette idée d’un honneur qui était issu des époques les plus vraies. En résumé un être « premier » resté dans le jus de la création divine. On ne pouvait qu’être en sécurité en des lieux ainsi peuplés.
Pour ceux-là, c’était aussi un mélange d’exotisme et de frisson qu’ils venaient chercher sur l’Île aux Oiseaux.
Dès qu’ils y avaient mis un pied, ils se mettaient en quête d’un terrain pour y bâtir ou d’une maison, que des îliens, humant un vent lucratif, s’employaient à construire en nombre à cet effet.
Dans les deux cas, c’étaient des autochtones qui vendaient, tout en assurant qu’ils étaient patriotes, très attachés à la terre de leurs ancêtres, terre qu’ils considéraient comme une sorte de sanctuaire.
Une fois sur le territoire insulaire, les nouveaux arrivants s’employaient à dompter les natifs dont on leur avait décrit le caractère, comme déjà indiqué.
Pour ce faire, et sachant qu’il avait à faire à des sortes de primates, le fraîchement débarqué se disait qu’il fallait nécessairement user de méthodes subtiles, comme celles utilisées pour apprivoiser les bêtes fauves, le primate n’en demeurant pas moins potentiellement dangereux. Aussi, la prudence s’imposait-elle.
Cela commençait par des tentatives, toujours maladroites, pour prononcer les noms de lieux et des gens selon l’usage local, comme le faisaient les natifs.
D’autres ne se donnaient même pas cette peine et continuaient à prononcer comme au premier jour (celui de leur arrivée), soit parce qu’ils étaient intellectuellement incapables de faire autrement (a-t-on besoin de l’enrichissement apporté par de telles personnes se disait Octave ?), soit parce qu’ils trouvaient qu’ils étaient d’une race supérieure et qu’ils n’avaient pas à s’abaisser à un tel effort.
Pour ceux qui essayaient c’était souvent peine perdue, le peu de natifs qui demeurait présent sur sa terre, et qui avait l’ouïe affûtée par les longs parcours sur la lande, identifiait l’intrus-comédien au premier son émis. Cela se traduisait par le fait de ressentir cette sorte de piqûre dont Octave s’était déjà fait l’écho, cher lecteur.
Ensuite, l’objectif de ces non-natifs était de pactiser, autant que faire se pouvait, avec le plus possible de natifs, le temps de déterminer ceux qui pourraient leur servir à une meilleure intégration, à savoir ne pas avoir d’ennui de quelque nature que ce fut, notamment ces ennuis qui étaient quelque peu assourdissants.
Le but de ces manœuvres n’était pas, on l’a compris, de mieux connaître (même s’il y avait quelquefois une part sincère de curiosité saine) l’âme de ce pays, et de ce qui restait de son peuple. C’était une visée purement utilitaire, dans la plupart des cas, une sorte d’assurance aussi, car on avait dit aux nouveaux arrivants que le natif était fort ombrageux et pouvait à tout moment faire le coup de poing et parfois même, même si cela se perdait, embraser les nuits de lueurs bleutées entraînant des dégâts immobiliers notables.
Attachés à leur patrimoine, les nouveaux arrivants voulaient surtout éviter cela, et étaient prêts ainsi à tous les sacrifices en prenant toutes précautions utiles.
Allant plus loin dans leur souci d’assurance, ils faisaient aussi allégeance en copinant – ostensiblement ou non – avec ceux qu’ils croyaient détenir le pouvoir du feu bleu de la nuit. Ainsi, ils s’arrangeaient aussi, comme cela leur était souvent suggéré, pour s’inscrire sur les listes électorales de l’Île aux Oiseaux et pour voter de façon visible pour des mouvements qui revendiquaient la protection de l’intégrité et de la pureté du territoire îlien. Pour éviter tout malentendu, souvent, ils donnaient procuration à des personnes sûres et bien identifiées, ce qui leur évitait de surcroît de faire un séjour sur l’Île pendant la période froide, celle généralement pendant laquelle se tenaient les opérations électorales.
Tout le monde y gagnait, l’électeur qui se disait que finalement c’était plus facile et moins coûteux qu’une surprime d’assurance, les élus qui engrangeaient un capital électoral non négligeable.
Voilà une autre illustration de la dépossession ou de ce qu’on pouvait appeler dans des terres du sud, la colonisation de peuplement.
Octave se disait que, de tous côtés, la machine à déposséder était en marche et qu’il allait être difficile de lutter si ceux vers lesquels il croyait pouvoir se tourner y participaient.
Tout cela engendrait en lui une certaine mélancolie…
À suivre...
Salluste