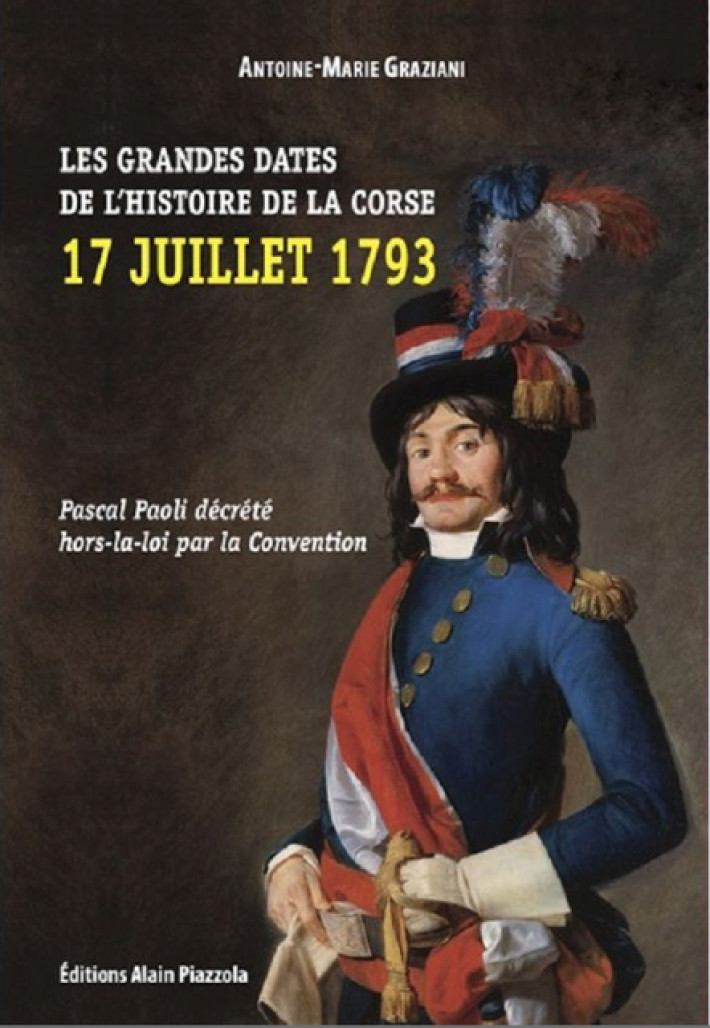17 juillet 1793 - Une date fondatrice, qui marque la rupture entre la Corse et la France révolutionnaire
Un livre passionnant et iconoclaste d'Antoine-Marie Graziani
17 juillet 1793 – Une date fondatrice
Un livre passionnant et iconoclaste d’Antoine-Marie Graziani
L’ouvrage 17 juillet 1793 inaugure une collection dirigée par l’historien Antoine-Marie Graziani et publiée par les éditions Piazzola. Le choix de cette date n’est pas anodin : elle marque la rupture entre la Corse et la France révolutionnaire, lorsque la Convention déclare Pascal Paoli « hors la loi » et place l’île en rébellion. Ce jour concentre plus de deux siècles de controverses et de mémoires politiques. Jusqu’alors il semblait acquis que Paoli avait rompu avec la Révolution par refus de la Terreur et de l’exécution de Louis XVI. Graziani donne ici une version complètement différente des raisons de cette fracture.
Dépasser les vulgates
L’ambition du livre est double : restituer la complexité de l’épisode et dépasser les lectures figées qui ont enfermé Paoli dans des caricatures – contre-révolutionnaire, Girondin, agent de l’Angleterre, précurseur de l’autonomie ou « despote éclairé ». Graziani montre un homme inséré dans un contexte mouvant, à la croisée d’idéaux et d’intérêts.
Le poids des sources et des mémoires
L’auteur reprend les sources à frais nouveaux : procès-verbaux de la Convention, correspondances inédites de Paoli (1789-1794), archives parlementaires. Il écarte les mémoires biaisés de Lucien ou Joseph Bonaparte et la tradition napoléonienne qui a effacé la dimension corse de la Révolution. Ces documents révèlent une chronologie révisée et ruinent plusieurs certitudes.
Une autonomie en lien
Graziani met en évidence le décalage entre l’intégration de 1789 et le langage des Corses, qui parlent surtout de « partage » ou de « connexion » avec la France. La Corse n’est pas absorbée mais associée ; les termes de « patrie » et de « nation » désignent d’abord l’île. Paoli revendique une administration conforme aux coutumes et une liberté garantie dans un cadre fédératif : une « autonomie en lien ».
Des fractures multiples
Lors de l’Assemblée d’Orezza (1790), Paoli, revenu d’exil, célèbre la fraternité franco-corse tout en prônant une large autonomie. La rupture de 1793 naît d’un enchevêtrement de fractures : guerre européenne, rivalités locales, querelles autour des biens nationaux. Saliceti et les Bonaparte profitent des ventes de terres ; les paolistes dénoncent une spoliation. Les intérêts économiques nourrissent les antagonismes politiques.
La fracture des générations
C’est aussi une opposition d’âges et de styles. Paoli, soixante-quatre ans, reste fidèle au modèle du Généralat (1755-1769). Ses jeunes rivaux – Saliceti, Pozzo di Borgo, Arena, les Bonaparte – manient clubs et alliances rapides, en phase avec la Révolution. Paoli, isolé et mal informé de Paris, conserve une vision idéalisée d’une France vertueuse, quand ses adversaires en perçoivent déjà les duretés partisanes.
Du romantisme à la spéculation
L’historien décrit le passage d’une phase idéologique à une phase dominée par la spéculation. Les ventes de biens nationaux, amorcées par le Plan Terrier, enrichissent une bourgeoisie locale, souvent issue du camp paoliste. Cette nouvelle couche sociale, intéressée à la propriété plus qu’à la liberté, rompt avec l’idéal héroïque du patriote. Le rêve républicain se dilue dans l’enrichissement privé.
Un acteur et une victime
La condamnation de Paoli par les Montagnards n’est pas seulement politique : elle résulte d’un entrelacs d’intérêts locaux et de luttes de pouvoir que Paris entérine. La rupture protège l’île des excès de la Terreur, mais Paoli n’en fut ni le stratège ni le vaincu volontaire : il devient tout à la fois acteur et victime d’un enchaînement historique.
La raison d’être du livre
La dimension historiographique est centrale : confronter récits et correspondances pour mesurer comment 1793 a été instrumentalisé. Graziani ne cherche pas une vérité définitive mais une pluralité de contextes et d’interprétations. Rendre à Paoli sa complexité, replacer la Corse dans la dynamique révolutionnaire européenne, relier les fractures insulaires aux convulsions françaises : telle est la démarche.
Une double contribution
17 juillet 1793 offre une double contribution : une lecture critique d’un moment décisif, affranchie des simplifications, et une réflexion sur les usages politiques de Paoli. L’île y apparaît comme un laboratoire politique où se posent des questions toujours actuelles : autonomie ou intégration, mémoire ou pouvoir, idéaux ou intérêts.
GXC
Les grandes dates de l’histoire de la Corse – 17 juillet 1793, Pascal Paoli… Antoine-Marie Graziani. Éd. Alain Piazzola. 15 €.
Un livre passionnant et iconoclaste d’Antoine-Marie Graziani
L’ouvrage 17 juillet 1793 inaugure une collection dirigée par l’historien Antoine-Marie Graziani et publiée par les éditions Piazzola. Le choix de cette date n’est pas anodin : elle marque la rupture entre la Corse et la France révolutionnaire, lorsque la Convention déclare Pascal Paoli « hors la loi » et place l’île en rébellion. Ce jour concentre plus de deux siècles de controverses et de mémoires politiques. Jusqu’alors il semblait acquis que Paoli avait rompu avec la Révolution par refus de la Terreur et de l’exécution de Louis XVI. Graziani donne ici une version complètement différente des raisons de cette fracture.
Dépasser les vulgates
L’ambition du livre est double : restituer la complexité de l’épisode et dépasser les lectures figées qui ont enfermé Paoli dans des caricatures – contre-révolutionnaire, Girondin, agent de l’Angleterre, précurseur de l’autonomie ou « despote éclairé ». Graziani montre un homme inséré dans un contexte mouvant, à la croisée d’idéaux et d’intérêts.
Le poids des sources et des mémoires
L’auteur reprend les sources à frais nouveaux : procès-verbaux de la Convention, correspondances inédites de Paoli (1789-1794), archives parlementaires. Il écarte les mémoires biaisés de Lucien ou Joseph Bonaparte et la tradition napoléonienne qui a effacé la dimension corse de la Révolution. Ces documents révèlent une chronologie révisée et ruinent plusieurs certitudes.
Une autonomie en lien
Graziani met en évidence le décalage entre l’intégration de 1789 et le langage des Corses, qui parlent surtout de « partage » ou de « connexion » avec la France. La Corse n’est pas absorbée mais associée ; les termes de « patrie » et de « nation » désignent d’abord l’île. Paoli revendique une administration conforme aux coutumes et une liberté garantie dans un cadre fédératif : une « autonomie en lien ».
Des fractures multiples
Lors de l’Assemblée d’Orezza (1790), Paoli, revenu d’exil, célèbre la fraternité franco-corse tout en prônant une large autonomie. La rupture de 1793 naît d’un enchevêtrement de fractures : guerre européenne, rivalités locales, querelles autour des biens nationaux. Saliceti et les Bonaparte profitent des ventes de terres ; les paolistes dénoncent une spoliation. Les intérêts économiques nourrissent les antagonismes politiques.
La fracture des générations
C’est aussi une opposition d’âges et de styles. Paoli, soixante-quatre ans, reste fidèle au modèle du Généralat (1755-1769). Ses jeunes rivaux – Saliceti, Pozzo di Borgo, Arena, les Bonaparte – manient clubs et alliances rapides, en phase avec la Révolution. Paoli, isolé et mal informé de Paris, conserve une vision idéalisée d’une France vertueuse, quand ses adversaires en perçoivent déjà les duretés partisanes.
Du romantisme à la spéculation
L’historien décrit le passage d’une phase idéologique à une phase dominée par la spéculation. Les ventes de biens nationaux, amorcées par le Plan Terrier, enrichissent une bourgeoisie locale, souvent issue du camp paoliste. Cette nouvelle couche sociale, intéressée à la propriété plus qu’à la liberté, rompt avec l’idéal héroïque du patriote. Le rêve républicain se dilue dans l’enrichissement privé.
Un acteur et une victime
La condamnation de Paoli par les Montagnards n’est pas seulement politique : elle résulte d’un entrelacs d’intérêts locaux et de luttes de pouvoir que Paris entérine. La rupture protège l’île des excès de la Terreur, mais Paoli n’en fut ni le stratège ni le vaincu volontaire : il devient tout à la fois acteur et victime d’un enchaînement historique.
La raison d’être du livre
La dimension historiographique est centrale : confronter récits et correspondances pour mesurer comment 1793 a été instrumentalisé. Graziani ne cherche pas une vérité définitive mais une pluralité de contextes et d’interprétations. Rendre à Paoli sa complexité, replacer la Corse dans la dynamique révolutionnaire européenne, relier les fractures insulaires aux convulsions françaises : telle est la démarche.
Une double contribution
17 juillet 1793 offre une double contribution : une lecture critique d’un moment décisif, affranchie des simplifications, et une réflexion sur les usages politiques de Paoli. L’île y apparaît comme un laboratoire politique où se posent des questions toujours actuelles : autonomie ou intégration, mémoire ou pouvoir, idéaux ou intérêts.
GXC
Les grandes dates de l’histoire de la Corse – 17 juillet 1793, Pascal Paoli… Antoine-Marie Graziani. Éd. Alain Piazzola. 15 €.