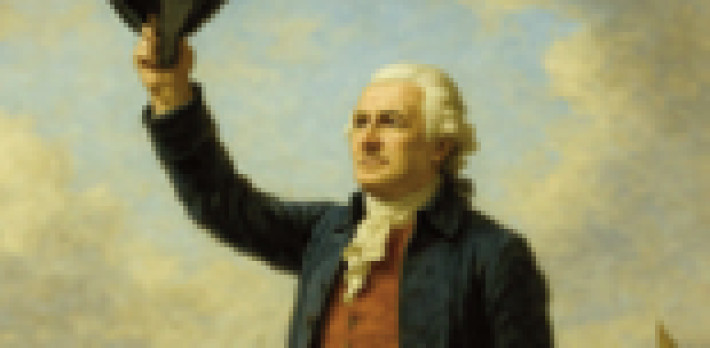Le 14 juillet de Pascal Paoli et de la Corse
NON Le premier 14 juillet n'a pas été français mais corse
Le 14 juillet de Pascal Paoli et de la Corse
Non le premier 14 juillet n’a pas été français mais corse. Le 14 juillet 1755, une consulta est réunie dans l’église du couvent de Sant’Antonio de la Casabianca, au cœur de la Castagniccia. Ce lieu, situé au carrefour de quatre pievi, a déjà servi de cadre à d’importantes assemblées et jouera encore ce rôle, notamment en 1797 lors du mouvement de la Crucetta. Les notables y prennent place sur une estrade improvisée. La réunion est présidée par le doyen d’âge, Giovan Quilico Casabianca, dans l’église des Servites.Une élection attendue
Pascal Paoli ne participe pas à la première partie de la réunion. Mais il connaît parfaitement l’ordre du jour et sait que la décision de le désigner général de la Nation a été prise bien en amont. Il est revenu de Longone dans ce but précis. Dès l’ouverture, la nécessité de désigner un chef est affirmée, et son nom est avancé sans surprise. Il bénéficie de soutiens solides : Venturini (le Vallerustie), Titto Buttafoco (la Casinca), Giovan Quilico Casabianca (l’Ampugnani), Don Simone Fabiani (la Balagne), Salvatore Ginestra (le Nebbio), et du prestige de son frère dans toute la Castagniccia.L’appel au futur général
Une fois l’élection acquise, une adresse est rédigée à l’intention du futur général, l’invitant à se présenter devant l’assemblée. Cette adresse lui est portée solennellement par un grand nombre des principaux sujets du Royaume. Paoli doit s’y rendre le lendemain, 15 juillet. Sa décision est déjà prise, mais il feint d’hésiter.Un refus de façade pour un engagement solennel
Dans une lettre du 16 juillet à son père, il explique :« Je parlais une heure entière pour refuser cet engagement, mais ce fut totalement en vain. J’ai fait un long sermon au peuple. »
Pourquoi cette mise en scène ? Pour obtenir des garanties fermes : il exige notamment la réalisation d’une marche générale le 3 août pour punir les délits et en finir avec les homicides. Car pour Paoli, le principal ennemi du Corse est le Corse lui-même, livré aux factions et aux vendettas, au lieu de se concentrer sur l’unité face à l’ennemi commun.
La paix civile comme priorité
Dès cette première assemblée, Paoli s’emploie à réconcilier les factions représentées dans l’assemblée : les deux groupes rivaux de Balagne, les villages de La Porta et de Croce d’Ampugnani, récemment en conflit, les communautés de Tavagna et de Campoloro. Dans sa lettre du 16 juillet, il écrit :« Mon souci principal sera de punir les délits, et d’empêcher les ligues pour maintenir l’union. »
Un pouvoir sans partage
On comprend mieux, dès lors, le ton de la lettre qu’il adresse à Ferdinando de Leon :« Le peuple m’a concédé plus d’autorité que n’en aurait voulu aucun roi de Corse, puisque le décret n’a aucune limitation. Ami, je suis Polichinelle jouant le Prince ! »
Il n’est donc nullement question de partager le pouvoir avec un autre chef, et surtout pas avec Matra ou Santucci, représentants d’un Magistrato déconsidéré, que Paoli juge obsolète dans sa correspondance.
Certes, il peut affirmer à son père que « jamais consulta plus régulière ne s’est tenue en Corse », mais tout n’est pas si parfait. Seize pievi seulement étaient représentées à Casabianca — soit à peine un quart des pievi de l’île. Le sud de la Corse est totalement absent, et ses adversaires peuvent rêver de convoquer une contre-assemblée ailleurs. Là encore, son image de « Polichinelle jouant le Prince » exprime l’ambivalence du moment : rien n’est encore joué.
La justice comme premier acte
Il est pourtant un domaine où Paoli agit sans attendre : la justice. Dans une Corse ravagée par la vendetta, il veut imposer l’autorité de l’État par des actes forts. En amont de la marche générale prévue pour le 3 août, il prononce des condamnations exemplaires : la mort pour certains, le fouet ou la marque d’infamie pour d’autres. Parmi les premiers jugés figurent des habitants de sa propre pieve.Il fait même exécuter un jeune parent de Pastoreccia, convaincu d’assassinat. Le fait choque, non par la sentence — ses prédécesseurs notamment les Génois avaient déjà appliqué une justice rigoureuse —, mais par le mépris du for ecclésiastique : le jeune homme est saisi dans une église, ce qui scandalise dans une société où le sacré protège encore le criminel. En Corse, la justice privée et les ligues familiales sont des piliers du pouvoir, et Paoli frappe fort : il rompt symboliquement avec l’ordre ancien.