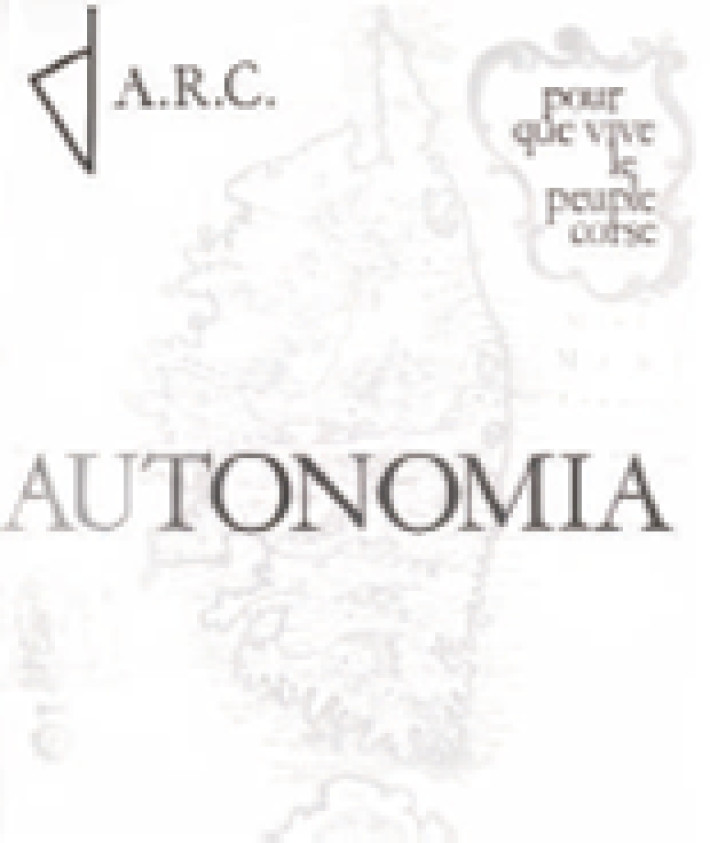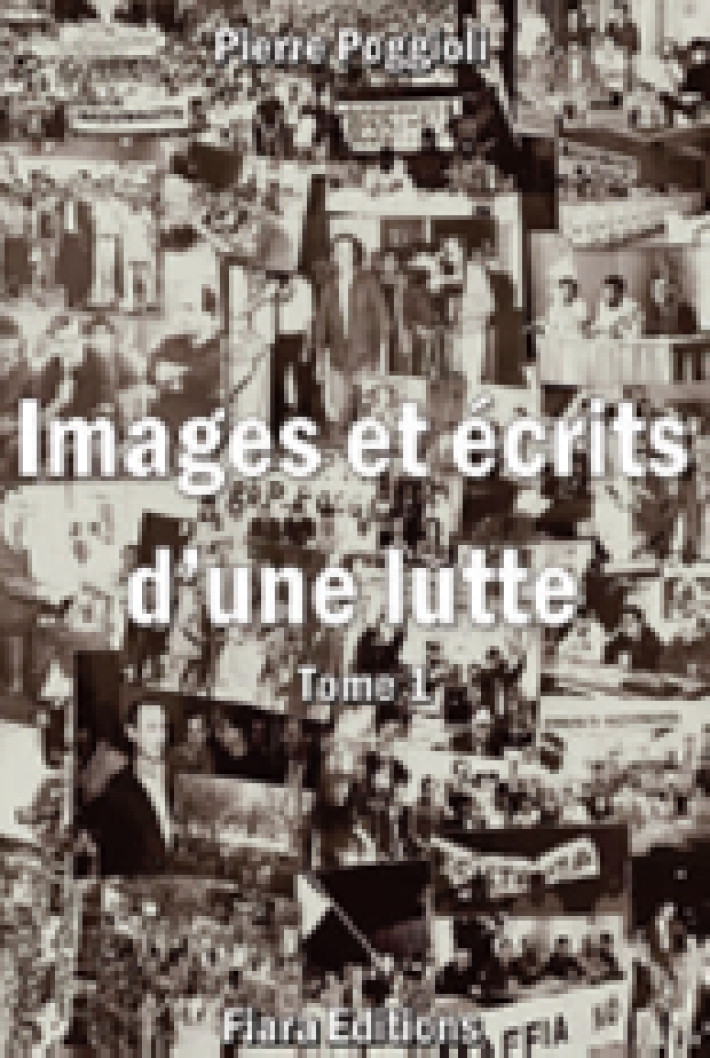50 ans aprés . Que reste -t-il d'Aleria ? N° 5
ALERIA....... et puis
Avant Aleria : une situation explosive
En 1974 et début 1975, avec les revendications autonomiste, économique, environnementales et culturelle, le refus de l’État d’apporter de véritables réformes, l’opposition des élus au changement et la montée en puissance des clandestins, tous les ingrédients sont en place pour une explosion.
La Corse est une grande oubliée de la France de l’après 1945. L’activité économique décline (fermeture d’une partie des entreprises industrielles, déclin de l’agriculture vivrière, désertification de l’intérieur) et l’effondrement démographique ayant débuté avec la saignée 1914-1918 s’aggrave (population vieillissante, départ vers « l’exil » de nombreux jeunes, 180 000 habitants en 1946 à 160 000 en 1960). Durant la deuxième moitié des années 1950, est enfin adopté un Plan d'action régional d’aménagement dont les objectifs sont de développer la production agricole et le tourisme. Pour la mise en œuvre, sont créées la Société d'aménagement pour la mise en valeur de la Corse (SOMIVAC) et la Société pour l'équipement touristique de la Corse (SETCO). Mais pour passer de planifier à agir, il faut du temps… Le marasme ne donne cependant pas lieu à une revendication organisée et massive. Celle-ci va être provoquée à la fin de l’année 1959 par la conjonction de deux objets de mécontentement : la vie chère, la menace de fermeture du réseau ferré. Le 29 novembre 1959 est créé, à Aiacciu, le Mouvement du 29 novembre que ses fondateurs décrivent revendicatif et rassembleur de toutes les forces démocratiques. Le 8 décembre, il organise une grande manifestation interprofessionnelle avec pour mots d’ordre « Tous unis contre la vie chère » et « Tous unis pour le maintien du chemin de fer ». Le projet d’abandon du réseau ferré sera en définitive enterré. Parallèlement à l’action de Mouvement du 29 novembre vont émerger et s’imposer les revendications économiques et fiscales initiées par le Groupement pour la Défense des Intérêts Économiques de la Corse (DIECO). Fil conducteur de toute cette activité revendicative : obtenir pour la Corse et les Corse une égalité de traitement leur permettant, tout comme la population et les département de l’Hexagone, de bénéficier du développement économique caractérisant la période que l’on appellera un jour les Trente glorieuses.
Revendication organisée et massive,
premiers attentats
Durant les années 1960, deux motifs majeurs de mécontentement puis de colère vont alimenter la revendication organisée et massive, et aussi créer les conditions et motifs de premiers attentats : l’affaire de L’Argentella ; l’aide importante notamment financière apportée à certains rapatriés la plupart venus d’Algérie s’étant installés sur l’île. L’affaire de L’Argentella éclate au printemps 1960. Souhaitant trouver un site d’essais nucléaire en remplacement de celui de Reggane situé dans le Sahara dont la pérennité risque d’être compromise par une accession de l’Algérie à l’indépendance (De Gaulle envisage déjà cette solution politique au conflit algérien), Paris à des vues sur l’ancienne mine de l’Argentella située entre Calvi et Galeria. La mobilisation organisée par le Mouvement du 29 novembre impose un abandon rapide du projet. Mais le mal est fait : il a été suscité le soupçon et même la conviction que la Corse est considérée par Paris comme un territoire de seconde zone. À partir de la fin des années 1950, alors que se désagrège l’Empire colonial, s’installent en Corse des familles venues de Tunisie, du Maroc et surtout d'Algérie. Au début, l’intégration se fait plutôt bien car beaucoup d’arrivants appartiennent à des familles corses. Mais certains de ces arrivants, plus particulièrement des exploitants agricoles venus d’Algérie, suscitent le rejet car jugés se comportant en colons. Ce rejet des « colons » est attisé par le fait que des aides à l’installation qui sont accordées à ces derniers, son prélevées dans les programmes et financements du Plan d'action régional d’aménagement mis en œuvre par la SOMIVAC et la SETCO. Ceci est à l’origine des attentats qui, dès le début des années 1960, sont commis contre des biens de rapatriés ou des équipements réalisés à l’initiative de la SOMIVAC ou de la SETCO.
Conséquences politique d’une journée
Isula morta et d’un plasticage
L’affaire des Boues rouges va créer les conditions de bien des événements ultérieurs. En avril 1972, le quotidien Le Provençal Corse révèle que la société italienne Montedison déverse quotidiennement des déchets chimiques au large du cap Corse. La découverte de plusieurs cétacés morts inquiète. Les travaux de la scientifique bastiaise Denise Viale sensibilisent l'opinion corse. Des voix alarmantes se font entendre hors de Corse dont celle du professeur Ezio Tongiorgi de l'Université de Pise qui affirme : « Les boues rouges sont hautement cancérigènes » et celle de Paul-Émile Victor, explorateur mondialement connu de l’Arctique et de l’Antarctique, qui lance : « Opposez-vous, même par la force, au rejet des boues rouges ! » Et ajoute à l’inquiétude des Corses, la récente révélation de la tragédie de Minamata (ville japonaise dont des milliers d’habitants sont les victimes d’un désastre environnemental et sanitaire causé par du mercure rejeté en mer étant passé dans la chaîne alimentaire marine puis humaine). Malgré les promesses de l’État d’intervenir auprès des autorités italiennes, rien ne bouge. La Montedison ne met pas fin aux déversements. Alors les Corses se mobilisent et expriment leur colère : le 17 février 1973, des milliers de manifestants défilent dans les rues de Bastia, la sous-préfecture est envahie, le sous-préfet est molesté. Edmond Simeoni, leader de l’ARC, et Vincent Duriani, un des responsables influents du Parti communiste en Corse, adjoint au maire de Bastia, qui étaient en première ligne, sont alors arrêtés et écroués quelques jours. Le 26 février, le Comité anti-boues rouges lance l’opération Isula Morta, grève générale bloquant l’ensemble des activités sur l’île. Mais les déversements continuent. En septembre, un attentat dans son port d’attache italien, endommage et immobilise un des deux navires qui effectuent les déversements. Deux jours plus tard, la justice italienne interdit au second navire de la Montedison d'appareiller. Fin des rejets. Les conséquences politiques de la journée Isula morta et du plasticage du Scarlino Secondo seront considérables. La journée Isula Morta restera gravée dans la mémoire collective comme le moment où les Corses ont su se rassembler et ont pu prendre conscience de leur force lorsqu’ils étaient unis. C’était une insurrection morale, une suspension du temps pour dire non à l’aveuglement d’un pouvoir central qui méprisait la terre et la mer corses. Ce jour-là, un peuple s’est regardé dans le miroir de sa propre histoire, et a vu se lever en lui la force du droit contre l’iniquité. La leçon sera retenue. Des mobilisations Isula morta et des manifestations massives permettront de réduire la marge de manœuvre de la répression contre les nationalistes. Le plasticage qui a mis fin au rejet des boues rouges sera fondateur pour de nombreux Corses d’une certaine légitimation et d’une crédibilité de l’action violente armée que le FLNC saura souvent politiquement exploiter. Ce plasticage représente l’instant fondateur où l’illégalité est devenue, aux yeux de beaucoup, légitime face à l’injustice légale.
Régionalisme puis autonomisme
Le retrait du projet de L’Argentella après l’abandon du projet de fermeture du réseau ferré va accréditer l’idée que pour être écouté, il convient d’établir avec Paris un rapport de force dans la rue. L’attribution à certains rapatriés d’une bonne partie de l’aide au développement qui initialement était destinée à la Corse et aux Corse, va ancrer le ressenti que ce territoire et ses habitants comptent peu pour Paris. Tout cela va constituer le terreau du passage d’une revendication d’égalité de traitement de la Corse et des Corses avec les départements de l'Hexagone et leurs habitants, vers une exigence de respect d’intérêts spécifiques de la Corse et des Corses. Ceci va avoir une traduction politique au milieu des années 1960 : la revendication régionaliste portée principalement par le Front Régionaliste Corse (FRC), le Partitu di u Populu Corsu (PPC) et l’Action Régionaliste Corse (ARC). Au début des années 1970, Paris n’ayant consenti aucun geste politique significatif de décentralisation et de remise en cause des politiques de développement économique des années 1960, et les élus corses faisant tout pour préserver un statut quo synonyme de maintien de leur pouvoir sur la société corse, le régionalisme va virer à l’autonomisme. En janvier 1973, plusieurs mouvements vont rédiger la Chjama di u Castellare, texte appelant à l’autonomie de la Corse et de ce fait constituant une rupture nette (affirmation d’un identité nationale corse, dénonciation de l’existence d’un ordre colonial français), et tentant en anticipant politiquement la prise en compte de ses revendications, d’éviter le basculement dans la violence armée clandestine (dont les signataires de la Chjama peuvent percevoir une prochaine organisation et montée en puissance). Le 26 juillet 1973, l’ARC devient l’Azzione per a Rinascita di a Corsica et revendique l’autonomie interne. Par ailleurs, la même année, en juin, à Beyrouth, lors d’une conférence internationale, José Stromboni, président de la Jeune Chambre Économique de Bastia, dénonce « la politique coloniale » menée par la France en Corse provoquant une ovation de la plupart des présents. Pour la première fois, la cause corse est internationalisée et inscrite dans les luttes des peuples pour leur dignité, leur environnement et leur autodétermination.
Explosion prévisible
Au début des années 1970, une nouvelle et explosive revendication se dessine. En Plaine orientale, une mobilisation paysanne s’oppose à un projet de complexe touristique de plusieurs dizaines de milliers de lits, entre Ghisonaccia et Aleria, sur une zone de terres agricoles et de littoral encore vierge. Cette mobilisation révèle une nouvelle dimension du réveil corse : la défense de la terre contre la spéculation et l’accaparement. Et comme lors de la mobilisation contre les déversements de boues rouges, des Corses affirment refuser que leur île soit sacrifiée à des intérêts extérieurs, prédateurs et destructeurs. La jonction entre défense de l’environnement et de l’agriculture, l’affirmation identitaire et culturelle qui s’exprime avec le Riacquistu naissant, et l’autonomisme donnent aux luttes corses une dimension politique qui inquiète les pouvoirs en place et une assise populaire significative. En 1974 et début 1975, avec les revendications autonomiste, économique, environnementale et culturelle, le refus de l’État d’apporter de véritables réformes, l’opposition des élus au changement et la montée en puissance des clandestins, tous les ingrédients sont en place pour une explosion. Elle aura lieu à Aleria. Pour mieux connaître et comprendre les événement de l’avant, le durant et l’après Aleria, trois ouvrages : « Corse des années ardentes 1939-1976 » (auteur Paul Silvani qui était journaliste du quotidien régional Le Provençal Corse) ; le Tome 1 de « Images et écrits d'une lutte » (auteur Pierre Poggioli, grande figure du nationalisme) ; « A utonomia » (projet d’autonomie interne de l’ARC).
La Redaction
Crédits photos : Éditions Albatros, Fiara Éditions, Arc
En 1974 et début 1975, avec les revendications autonomiste, économique, environnementales et culturelle, le refus de l’État d’apporter de véritables réformes, l’opposition des élus au changement et la montée en puissance des clandestins, tous les ingrédients sont en place pour une explosion.
La Corse est une grande oubliée de la France de l’après 1945. L’activité économique décline (fermeture d’une partie des entreprises industrielles, déclin de l’agriculture vivrière, désertification de l’intérieur) et l’effondrement démographique ayant débuté avec la saignée 1914-1918 s’aggrave (population vieillissante, départ vers « l’exil » de nombreux jeunes, 180 000 habitants en 1946 à 160 000 en 1960). Durant la deuxième moitié des années 1950, est enfin adopté un Plan d'action régional d’aménagement dont les objectifs sont de développer la production agricole et le tourisme. Pour la mise en œuvre, sont créées la Société d'aménagement pour la mise en valeur de la Corse (SOMIVAC) et la Société pour l'équipement touristique de la Corse (SETCO). Mais pour passer de planifier à agir, il faut du temps… Le marasme ne donne cependant pas lieu à une revendication organisée et massive. Celle-ci va être provoquée à la fin de l’année 1959 par la conjonction de deux objets de mécontentement : la vie chère, la menace de fermeture du réseau ferré. Le 29 novembre 1959 est créé, à Aiacciu, le Mouvement du 29 novembre que ses fondateurs décrivent revendicatif et rassembleur de toutes les forces démocratiques. Le 8 décembre, il organise une grande manifestation interprofessionnelle avec pour mots d’ordre « Tous unis contre la vie chère » et « Tous unis pour le maintien du chemin de fer ». Le projet d’abandon du réseau ferré sera en définitive enterré. Parallèlement à l’action de Mouvement du 29 novembre vont émerger et s’imposer les revendications économiques et fiscales initiées par le Groupement pour la Défense des Intérêts Économiques de la Corse (DIECO). Fil conducteur de toute cette activité revendicative : obtenir pour la Corse et les Corse une égalité de traitement leur permettant, tout comme la population et les département de l’Hexagone, de bénéficier du développement économique caractérisant la période que l’on appellera un jour les Trente glorieuses.
Revendication organisée et massive,
premiers attentats
Durant les années 1960, deux motifs majeurs de mécontentement puis de colère vont alimenter la revendication organisée et massive, et aussi créer les conditions et motifs de premiers attentats : l’affaire de L’Argentella ; l’aide importante notamment financière apportée à certains rapatriés la plupart venus d’Algérie s’étant installés sur l’île. L’affaire de L’Argentella éclate au printemps 1960. Souhaitant trouver un site d’essais nucléaire en remplacement de celui de Reggane situé dans le Sahara dont la pérennité risque d’être compromise par une accession de l’Algérie à l’indépendance (De Gaulle envisage déjà cette solution politique au conflit algérien), Paris à des vues sur l’ancienne mine de l’Argentella située entre Calvi et Galeria. La mobilisation organisée par le Mouvement du 29 novembre impose un abandon rapide du projet. Mais le mal est fait : il a été suscité le soupçon et même la conviction que la Corse est considérée par Paris comme un territoire de seconde zone. À partir de la fin des années 1950, alors que se désagrège l’Empire colonial, s’installent en Corse des familles venues de Tunisie, du Maroc et surtout d'Algérie. Au début, l’intégration se fait plutôt bien car beaucoup d’arrivants appartiennent à des familles corses. Mais certains de ces arrivants, plus particulièrement des exploitants agricoles venus d’Algérie, suscitent le rejet car jugés se comportant en colons. Ce rejet des « colons » est attisé par le fait que des aides à l’installation qui sont accordées à ces derniers, son prélevées dans les programmes et financements du Plan d'action régional d’aménagement mis en œuvre par la SOMIVAC et la SETCO. Ceci est à l’origine des attentats qui, dès le début des années 1960, sont commis contre des biens de rapatriés ou des équipements réalisés à l’initiative de la SOMIVAC ou de la SETCO.
Conséquences politique d’une journée
Isula morta et d’un plasticage
L’affaire des Boues rouges va créer les conditions de bien des événements ultérieurs. En avril 1972, le quotidien Le Provençal Corse révèle que la société italienne Montedison déverse quotidiennement des déchets chimiques au large du cap Corse. La découverte de plusieurs cétacés morts inquiète. Les travaux de la scientifique bastiaise Denise Viale sensibilisent l'opinion corse. Des voix alarmantes se font entendre hors de Corse dont celle du professeur Ezio Tongiorgi de l'Université de Pise qui affirme : « Les boues rouges sont hautement cancérigènes » et celle de Paul-Émile Victor, explorateur mondialement connu de l’Arctique et de l’Antarctique, qui lance : « Opposez-vous, même par la force, au rejet des boues rouges ! » Et ajoute à l’inquiétude des Corses, la récente révélation de la tragédie de Minamata (ville japonaise dont des milliers d’habitants sont les victimes d’un désastre environnemental et sanitaire causé par du mercure rejeté en mer étant passé dans la chaîne alimentaire marine puis humaine). Malgré les promesses de l’État d’intervenir auprès des autorités italiennes, rien ne bouge. La Montedison ne met pas fin aux déversements. Alors les Corses se mobilisent et expriment leur colère : le 17 février 1973, des milliers de manifestants défilent dans les rues de Bastia, la sous-préfecture est envahie, le sous-préfet est molesté. Edmond Simeoni, leader de l’ARC, et Vincent Duriani, un des responsables influents du Parti communiste en Corse, adjoint au maire de Bastia, qui étaient en première ligne, sont alors arrêtés et écroués quelques jours. Le 26 février, le Comité anti-boues rouges lance l’opération Isula Morta, grève générale bloquant l’ensemble des activités sur l’île. Mais les déversements continuent. En septembre, un attentat dans son port d’attache italien, endommage et immobilise un des deux navires qui effectuent les déversements. Deux jours plus tard, la justice italienne interdit au second navire de la Montedison d'appareiller. Fin des rejets. Les conséquences politiques de la journée Isula morta et du plasticage du Scarlino Secondo seront considérables. La journée Isula Morta restera gravée dans la mémoire collective comme le moment où les Corses ont su se rassembler et ont pu prendre conscience de leur force lorsqu’ils étaient unis. C’était une insurrection morale, une suspension du temps pour dire non à l’aveuglement d’un pouvoir central qui méprisait la terre et la mer corses. Ce jour-là, un peuple s’est regardé dans le miroir de sa propre histoire, et a vu se lever en lui la force du droit contre l’iniquité. La leçon sera retenue. Des mobilisations Isula morta et des manifestations massives permettront de réduire la marge de manœuvre de la répression contre les nationalistes. Le plasticage qui a mis fin au rejet des boues rouges sera fondateur pour de nombreux Corses d’une certaine légitimation et d’une crédibilité de l’action violente armée que le FLNC saura souvent politiquement exploiter. Ce plasticage représente l’instant fondateur où l’illégalité est devenue, aux yeux de beaucoup, légitime face à l’injustice légale.
Régionalisme puis autonomisme
Le retrait du projet de L’Argentella après l’abandon du projet de fermeture du réseau ferré va accréditer l’idée que pour être écouté, il convient d’établir avec Paris un rapport de force dans la rue. L’attribution à certains rapatriés d’une bonne partie de l’aide au développement qui initialement était destinée à la Corse et aux Corse, va ancrer le ressenti que ce territoire et ses habitants comptent peu pour Paris. Tout cela va constituer le terreau du passage d’une revendication d’égalité de traitement de la Corse et des Corses avec les départements de l'Hexagone et leurs habitants, vers une exigence de respect d’intérêts spécifiques de la Corse et des Corses. Ceci va avoir une traduction politique au milieu des années 1960 : la revendication régionaliste portée principalement par le Front Régionaliste Corse (FRC), le Partitu di u Populu Corsu (PPC) et l’Action Régionaliste Corse (ARC). Au début des années 1970, Paris n’ayant consenti aucun geste politique significatif de décentralisation et de remise en cause des politiques de développement économique des années 1960, et les élus corses faisant tout pour préserver un statut quo synonyme de maintien de leur pouvoir sur la société corse, le régionalisme va virer à l’autonomisme. En janvier 1973, plusieurs mouvements vont rédiger la Chjama di u Castellare, texte appelant à l’autonomie de la Corse et de ce fait constituant une rupture nette (affirmation d’un identité nationale corse, dénonciation de l’existence d’un ordre colonial français), et tentant en anticipant politiquement la prise en compte de ses revendications, d’éviter le basculement dans la violence armée clandestine (dont les signataires de la Chjama peuvent percevoir une prochaine organisation et montée en puissance). Le 26 juillet 1973, l’ARC devient l’Azzione per a Rinascita di a Corsica et revendique l’autonomie interne. Par ailleurs, la même année, en juin, à Beyrouth, lors d’une conférence internationale, José Stromboni, président de la Jeune Chambre Économique de Bastia, dénonce « la politique coloniale » menée par la France en Corse provoquant une ovation de la plupart des présents. Pour la première fois, la cause corse est internationalisée et inscrite dans les luttes des peuples pour leur dignité, leur environnement et leur autodétermination.
Explosion prévisible
Au début des années 1970, une nouvelle et explosive revendication se dessine. En Plaine orientale, une mobilisation paysanne s’oppose à un projet de complexe touristique de plusieurs dizaines de milliers de lits, entre Ghisonaccia et Aleria, sur une zone de terres agricoles et de littoral encore vierge. Cette mobilisation révèle une nouvelle dimension du réveil corse : la défense de la terre contre la spéculation et l’accaparement. Et comme lors de la mobilisation contre les déversements de boues rouges, des Corses affirment refuser que leur île soit sacrifiée à des intérêts extérieurs, prédateurs et destructeurs. La jonction entre défense de l’environnement et de l’agriculture, l’affirmation identitaire et culturelle qui s’exprime avec le Riacquistu naissant, et l’autonomisme donnent aux luttes corses une dimension politique qui inquiète les pouvoirs en place et une assise populaire significative. En 1974 et début 1975, avec les revendications autonomiste, économique, environnementale et culturelle, le refus de l’État d’apporter de véritables réformes, l’opposition des élus au changement et la montée en puissance des clandestins, tous les ingrédients sont en place pour une explosion. Elle aura lieu à Aleria. Pour mieux connaître et comprendre les événement de l’avant, le durant et l’après Aleria, trois ouvrages : « Corse des années ardentes 1939-1976 » (auteur Paul Silvani qui était journaliste du quotidien régional Le Provençal Corse) ; le Tome 1 de « Images et écrits d'une lutte » (auteur Pierre Poggioli, grande figure du nationalisme) ; « A utonomia » (projet d’autonomie interne de l’ARC).
La Redaction
Crédits photos : Éditions Albatros, Fiara Éditions, Arc