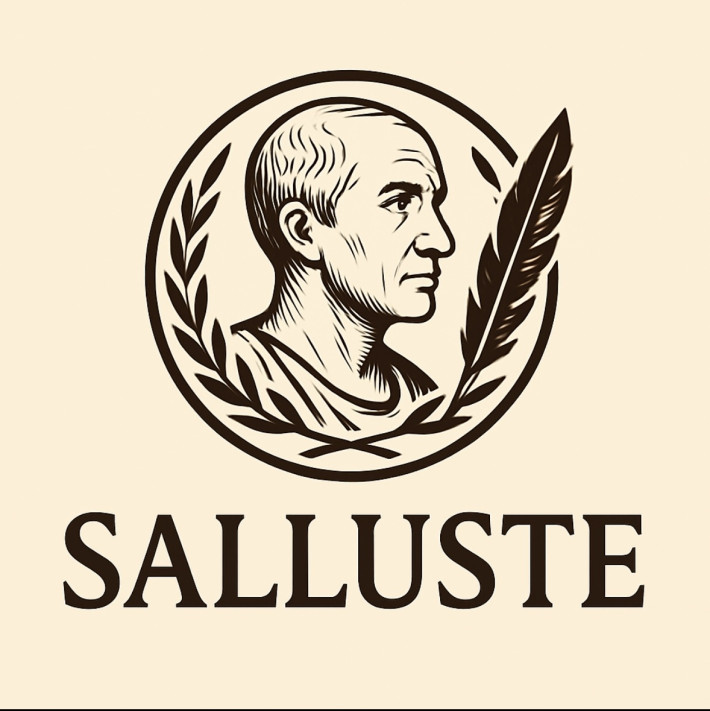Chroniques d'Octave, natif de l'Ile-aux -Oiseaux.....
L'envahissement
Chroniques d’Octave, natif de l’Ile-aux-Oiseaux…
L’envahissement
C’était la période pendant laquelle l’Ile-aux-Oiseaux était envahie par des foules débridées qui voulaient profiter de son soleil, de ses landes aux herbes folles et aux senteurs profondes. Elles voulaient aussi se baigner dans les lacs aux reflets argentés et voir le soleil se coucher dessus, et plonger dans l’Océan qui leur apportait une fraîcheur tonique.
C’était l’envahissement !
Le chemin d’Ulpien
En temps ordinaires Octave mettait dix minutes pour se rendre chez son ami Ulpien. Mais en cette période, il lui fallait presque le double, car les routes de l’Ile-aux-Oiseaux étaient encombrées par divers équipages qui ne maîtrisaient pas les codes locaux, ni même de quelconques codes d’ailleurs. Ils roulaient très lentement sans laisser passer l’autochtone qu’il était et, parfois, poussaient l’audace jusqu’à s’ingénier à empêcher volontairement tout dépassement tant ils se croyaient en terrain conquis, se disant que la route était à eux comme aux autres (et plutôt à eux). Ils étaient aussi persuadés du fait que sans eux et les quelques dépenses qu’ils faisaient sur le territoire insulaire, les habitants de l’Île-aux-Oiseaux seraient fort dépourvus. Ils se considéraient ainsi comme des sortes de bienfaiteurs de l’humanité, rien de moins !
Le fusil à silex
Un jour, sur une route de montagne, Octave ne parvenait pas à doubler un non-natif qui refusait de surcroît de serrer à droite, alors que la chaussée permettait en plusieurs endroits de le faire et cela pendant près d’une vingtaine de minutes. La patience d’Octave fut mise à rude épreuve, ce qui le contraint à user de son vieux fusil à silex, qu’il emportait toujours avec lui dans ses déplacements, pour tirer un coup en l’air et signifier à celui qui le bloquait que la comédie n’avait que trop duré. L’effet fut heureusement immédiat, car le visiteur avait — enfin — perçu qu’il ne fallait pas trop chatouiller l’indigène et qu’il était plus prudent de revenir à la raison.
Le droit naturel
Certains pourraient être choqués par de telles pratiques possiblement qualifiées de barbares ou de primitives, mais elles paraissaient à Octave, être par nature doux, comme parfaitement adaptées en réponse à un comportement on ne peut plus discourtois. S’il fallait recommencer, il n’hésiterait pas un seul instant, car il avait le sentiment d’avoir rétabli un ordre naturel. Peu lui importait de heurter l’opinion des pouvoirs établis (par leurs représentants non-natifs) selon lequel la détention d’un fusil à silex, comme de tout ce qui pouvait s’apparenter à une arme, était la marque d’un sous-développement de la pensée. Octave pensait, au contraire, que la détention de moyens de défense, y compris contre l’État, relevait d’un droit naturel des habitants de l’Ile-aux-Oiseaux.
Il lui revenait aussi en mémoire ce constat d’un auteur ancien selon lequel celui qui détient un pouvoir a tendance à en abuser et dont il est ainsi prudent de se prémunir si de telles situations adviennent. Il avait même entendu dire que dans d’autres pays, que l’on considérait pourtant comme fort civilisés, on pouvait très naturellement, et que c’était même un droit, détenir et même porter des armes sur soi. Octave trouvait cela fort judicieux.
Les esprits serviles
Il se réjouissait même alors lorsqu’il entendait les gens ordinaires pousser des cris suraigus à l’énoncé de ces évidences, lesquelles pourtant devaient, selon lui, être considérées comme la marque d’un des éléments majeurs de la protection des droits de l’homme. Hélas, ces pisse-froid aux idées rases et aux cerveaux inachevés étaient légion, toujours dans le suivisme et l’assentiment à ce que toute autorité, même la plus illégitime, pouvait énoncer. Ces gens n’étaient pas des hommes se disait Octave, ils méritaient d’être maintenus dans l’état de servitude qui, seul, les maintenait debout. Ceux-là ne savaient pas d’ailleurs vivre autrement, à savoir sans le joug de leurs maîtres, c’est-à-dire des pouvoirs établis, quoi qu’ils disent, quoi qu’ils fassent. Octave et quelques-uns de ses amis natifs, quant à eux, entendaient bien conserver leurs antiques coutumes, qu’ils trouvaient au demeurant fort adaptées aux temps présents.
La protection imposée
Octave avait également en horreur les justifications qui étaient données à la mise en place de cet état de contrôle permanent des faits et gestes de tous : il s’agissait disait-on d’assurer le bien commun et ainsi de nous protéger, de tout, de ceci de cela, on ne savait même plus trop, car, à force de protection, on se demandait s’il existait encore un danger. Et puis, Octave se disait qu’il se protégeait très bien tout seul d’un certain nombre de choses, d’un certain nombre de gens, sans avoir besoin en permanence d’un soutien extérieur.
Les non-natifs, qui étaient de plus en plus nombreux sur l’Ile-aux-Oiseaux, considéraient cette approche et ces réactions comme relevant d’un stade de l’évolution qui était celui des époques d’avant ce qu’ils appelaient « la civilisation ». Ils considéraient les autochtones comme des sortes de primates qu’ils observaient avec une certaine curiosité, heureusement mêlée de crainte. Ils poussaient des petits cris d’effroi, lorsqu’ils évoquaient tout cela avec leur façon de parler marquée par l’émission d’un son qui suscitait, on l’a déjà évoqué, un trouble chez les natifs assimilables à celui d’une piqûre par, nécessairement, un instrument pointu. On pouvait même assister, ce qui était d’ailleurs fort plaisant, à des manifestations d’hystérie et de panique de la part de ces mêmes non-natifs à ces évocations, avec des montées dans les aigus, ce qui réjouissait Octave et ses amis.
Le mépris de la terre ferme
Ce qui heurtait aussi beaucoup Octave, comme ses amis, était le complexe de supériorité des gens de la terre ferme. Ces derniers, même dans les milieux dits intellectuels se targuant ainsi d’une tolérance naturelle et d’une ouverture d’esprit qu’ils considéraient comme consubstantielle à leur état, estimaient que la jeunesse de l’Ile-aux-Oiseaux ne pouvait recevoir utilement « la science » et faire l’apprentissage de la hauteur de vue propre aux peuples civilisés que dans les institutions d’éducation de la terre ferme. En cela ils révélaient ce qu’il fallait bien qualifier de forme de mépris à l’égard de ceux qui sur l’Ile-aux-Oiseaux osaient ainsi prétendre faire partager par la jeunesse les outils lui permettant de mieux connaître le monde.
Pour ces « grands intellectuels », l’Ile-aux-Oiseaux ne pouvait exister que par ses liens avec la terre ferme et sous la dépendance de ses élites. Octave se disait que ceux qui faisaient en quelque sorte profession d’altruisme sur la terre ferme n’étaient en réalité que de petites gens qui n’aimaient qu’eux-mêmes et considéraient le reste du genre humain comme une réunion de sous-hommes. Octave notait avec tristesse que beaucoup sur l’Ile-aux-Oiseaux suivaient les oukases de ces sachants relayés localement par des natifs, laquais de tous les pouvoirs, qui se pensent ainsi différents et éminents parce qu’ils sont reliés à ce qu’il leur apparaît comme le plus brillant et évolué sur la terre ferme. Tout cela, qui n’était en réalité qu’une forme de soumission, appelée aussi dans certains pays « complexe du colonisé », laissait Octave perplexe.
À suivre…
SALLUSTE