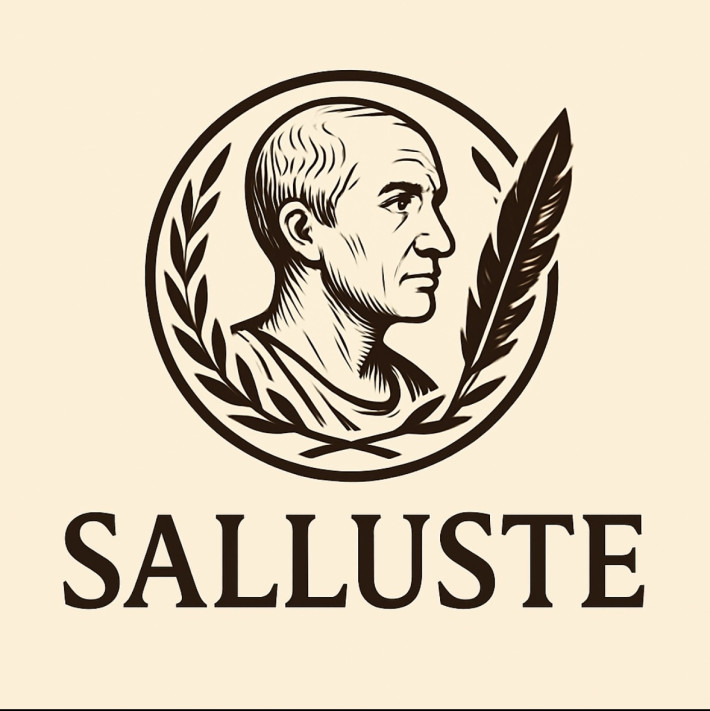Pour être modernes, soyons archaïques
« Les Corses sont les seuls en France qui s’en sortiront, car ils sont restés archaïques.......
Pour être modernes, soyons archaïques !
Dans son beau roman Les Loups de Tanger — dont on conseille la lecture tant il brosse un tableau subtil de notre île et de ses habitants, loin des clichés de ceux qui viennent d’ailleurs et qui ne comprennent rien —, Jacques de Saint-Victor prête à un de ses personnages les propos suivants : « Les Corses sont les seuls en France qui s’en sortiront, car ils sont restés archaïques. Bientôt ce sera la seule façon de survivre dans le chaos dissolvant de la modernité. »
Rien n’est plus vrai.
Mais il est vrai aussi que le personnage du roman prononce ces paroles dans les années cinquante. La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si le temps qui a passé nous a fait perdre toutes velléités de retrouver notre âme première, car la Corse de ce siècle est fort éloignée de celle de ces temps. Ce qu’il nous faut comprendre, c’est que le salut ne peut venir que d’un retour vers un fond de pureté archaïque, en espérant que nous ne l’avons pas définitivement perdu. Ce que nous ne croyons pas, car l’homme reste un animal et il garde en lui, même profondément enfouie, la ressource vitale.
De la modernité à la postmodernité
Aujourd’hui, nous avons passé le cap de la modernité pour être dans une postmodernité dont le bain est encore plus dissolvant, et cela était fort prévisible tant le chemin était tracé avec l’avènement de ce qu’on nous a présenté comme constitutif d’une aube nouvelle. Ceux qui, chez nous, prétendent incarner la tradition et la défense de notre façon ancestrale d’être au monde (qu’il conviendra de précisément définir) ont manifestement failli, tant ils sont plongés, avec une délectation feinte, dans le politiquement correct « woke » et bien-pensant. Il fallait bien donner des gages aux bourgeois de l’autre rive pour bien leur signifier qu’ils étaient en réalité des leurs. Il fallait aussi être moderne, loin donc de l’archaïsme. Car tout ce beau monde, en deçà comme sur l’île, est pénétré de l’idée de progrès issue des fausses Lumières — si meurtrières — de 1789. Dès lors, comment incarner le retour à l’archaïsme salvateur ? La « feuille de route » qui allait être mise en œuvre ne pouvait qu’être imprégnée de ces principes « fondateurs ». Fous sont ceux qui ont cru à autre chose.
Redéfinir l’archaïsme salvateur
Mais allons plus loin. Dans la période de grande déliquescence qui est la nôtre, et pour notre île, que pourrait signifier le fait d’être archaïque ? La question doit être posée, car nous avons perdu beaucoup de nos instincts premiers. La vie au village a disparu presque partout avec les étalements urbains dans les plaines et les périphéries des villes, accrus par l’arrivée d’une population aux origines mêlées. Dans les temps passés, la vie de nos anciens était marquée par une certaine frugalité, par la force des choses, car nous étions une civilisation agropastorale avec une économie de subsistance (hormis pour quelques rares privilégiés). Les solidarités alors existaient de façon prépondérante par nécessité. Même si l’homme demeurait l’homme en ces périodes (souvent idéalisées), avec ses forces et ses faiblesses, il faut en rester conscient. Mais ce qui était le plus marquant et singulier, c’était sans doute la méfiance qui régnait à l’égard de la puissance publique, quelle qu’elle fût. Saine méfiance, sans doute issue d’une soif de liberté et de la volonté d’être son propre maître, et ainsi de se méfier des corps constitués et établis. Un sentiment fort moderne et d’actualité, finalement. C’est ce sentiment qu’il faut retrouver pour un peuple en voie de disparition, ou plutôt qui voit fort atteint ce qui constituait sa substance et donnait corps à son unité. En sommes-nous capables ? C’est là toute la question.
Le lieu et le lien
Notre substance, on le sait, se trouve dans le village, dans l’intérieur, dans tout ce qui est loin des côtes (sauf pour quelques exceptions), autrefois si inhospitalières, infestées de malaria et soumises aux attaques venues de la mer menées notamment par ce qu’il était convenu d’appeler les Barbaresques. C’est cela qui fit notre identité, et c’est cela que nous avons perdu par l’ouverture vers les plaines, entraînant la désertification de l’intérieur et la surpopulation des structures urbaines existantes. C’est ce lien qu’il faut recréer et retrouver pour notre salut. Car, comme le souligne Michel Maffesoli (dont on ne peut que recommander la lecture des ouvrages pour comprendre notre monde), c’est le lieu qui fait le lien. C’est le lieu qui structure, ce sont les racines qui structurent, n’en déplaise aux tenants de la déconstruction généralisée. Or, le lieu d’unité n’existe plus, car nous avons perdu l’intérieur, ce qui nous a éloignés de notre intérieur. C’est cela qui nous a fait perdre notre soif de liberté. On nous a achetés par le déferlement des masses estivales, accompagné de l’argent qui a coulé à flots pour certains, perturbant les vieux équilibres mais surtout rompant notre lien séculaire avec les terres de l’intérieur. Ce moment fut le point de bascule. Allons-nous pouvoir surmonter ce moment qui dure ? Rien n’est moins certain.
La dépendance moderne
Nous sommes entrés de plain-pied dans l’ère du consumérisme exacerbé, dans une ère connectée, et c’est là le pire. Aussi, nous sommes devenus dépendants de ces choses appelées « smartphones », qui sont le support des atteintes à nos libertés. Les objets dits « connectés » pullulent et beaucoup, pour se croire et paraître modernes, s’enorgueillissent de leur usage. Nous ne pensons plus, nous vivons dans une course sans fin vers le progrès toujours recommencé (pléonasme). Nous nous repaissons de tout ce qui nous coupe de la terre, de notre intérieur, de tout ce qui constitue notre âme. Nous étions une « île sans rivages », du nom du beau recueil de textes de Marie Susini, qui avait tout compris. Nous sommes devenus un rivage ouvert aux quatre vents, qui balaient tout, même l’écume des jours.
Salluste